« Il faut sublimer la part lumineuse des Beaufs et des Barbares » – Un entretien avec Houria Bouteldja
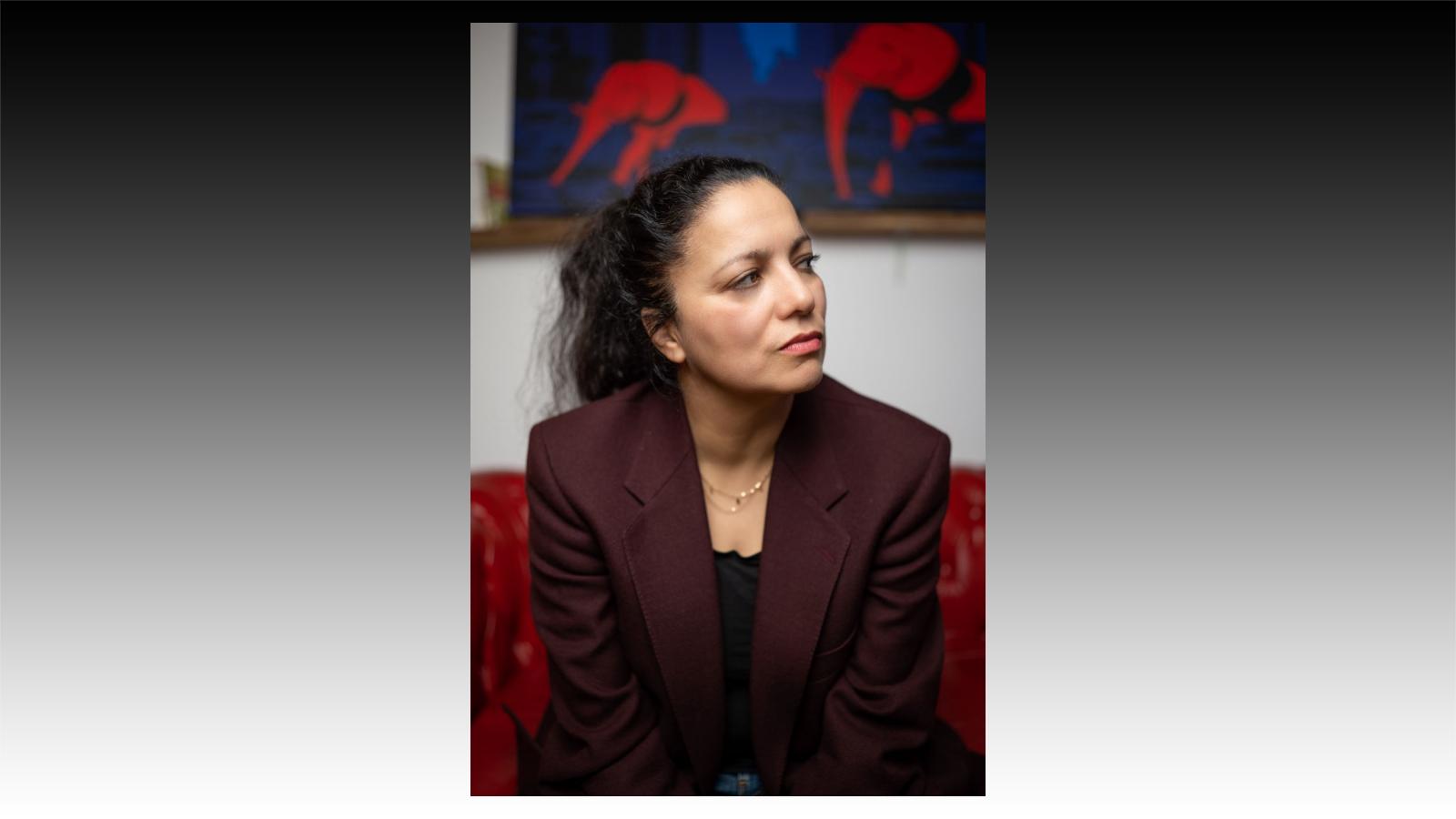
Azadî : Dans ton nouveau livre paru aux éditions La Fabrique, tu as choisi comme sous-titre « Le pari du nous » alors qu’il y a déjà un « nous » dans ton premier livre Les Blancs, les Juifs, et Nous. Ce dernier « Nous » semble être un « Nous » d’indigènes, alors que le « Nous » de ton nouveau livre semble inclure d’autres catégories. Quelles sont-elles ? Qui est ce « Nous » ?
Houria : En fait, ces deux « Nous » sont aussi anciens l’un que l’autre. Au Parti des Indigènes, nous avons toujours défendu l’existence de plusieurs « Nous ». Le premier « Nous » est social, c’est celui de la condition indigène, des post-colonisés vivant en France. Celui qui regroupe dans une même communauté de destin les populations issues de l’histoire coloniale et de l’histoire de l’esclavage, et qui vivent sous le régime du racisme structurel. Ce premier « Nous » est strictement social et historique. Ensuite il y a le “Nous” de l’indigène politique. C’est celui de l’Indigène qui s’engage dans la lutte et plus particulièrement dans l’antiracisme politique, qui s’engage à créer une force autonome dirigée par et pour les indigènes tout simplement. Et il y a le troisième “Nous” qui est celui de la majorité décoloniale et qu’on peut assimiler à un bloc historique. Ce « Nous » existe au PIR depuis le début. C’est un « Nous » de l’alliance avec les blancs. Dans le premier livre, je me suis effectivement concentrée sur les deux premiers « Nous »: le social et le politique. Pour autant, je n’oubliais pas le « Nous » décolonial, celui de l’alliance, qui est contenu dans l’idée d’amour révolutionnaire et qui a toujours cohabité avec les autres « Nous » au sein du PIR comme perspective stratégique. L’amour révolutionnaire comprend les autres « Nous », celui des blancs et celui des juifs. Trois groupes qui constituent des groupes raciaux en apparence irréconciliables en France. L’amour révolutionnaire est le dépassement de ces trois « Nous » vers une collectivité politique capable de créer un rapport de force contre le bloc au pouvoir. Le « Nous » du « pari du Nous » est l’incarnation de l’amour révolutionnaire. Quelle est la voix stratégique pour arriver vers ce « Nous » là ? Ce livre est une tentative pour y répondre. Je ne dis pas que tout est dans le bouquin vert, je n’ai pas cette prétention, mais j’essaye de tracer des lignes pour aller vers ce « Nous » politique qui est aussi un « Nous » révolutionnaire.
Azadî : Avant de savoir comment arriver au « Nous » révolutionnaire, tu essayes de montrer pourquoi jusqu’ici il ne s’est pas réalisé. Tu poses les bases. Pour toi, c’est à cause de l’État racial intégral et son pacte racial. C’est la première partie du livre dans laquelle tu fais une analyse matérialiste de presque 500 ans de formation de ce que tu nommes l’État racial intégral. Que vient préciser ce concept ?
Houria : J’essaie de donner un contenu concret à la notion de racisme systémique. J’étais assez insatisfaite de la définition que nous-mêmes dans le mouvement décolonial nous en donnions, parce que ça restait abstrait, ça manquait de matière. Et puis j’ai rencontré Gramsci et son concept d’État intégral. Il le définit comme l’association de trois instances : l’État et ses institutions, plus la société politique, plus la société civile. C’est ce qui fait la cohérence générale de l’État, son existence et sa pérennité. Chez Gramsci, cette analyse était appliquée à l’État bourgeois. Ce qui fait la pérennité de l’État bourgeois est le lien organique qui s’est créé avec le temps – notamment par l’émergence et la constitution des États-nations – entre l’État, les organisations politiques qui représentent les fractions du peuple selon leurs intérêts, et la société civile. Sur la base de cette idée, je me suis dit que l’on pouvait appréhender la question de la race et du racisme à travers le concept d’État intégral parce qu’il manquait à l’analyse de Poulantzas, de Gramsci ou des intellectuels d’aujourd’hui sa dimension raciale. Pourquoi ça marche, le racisme ? Pourquoi ça tient et pourquoi c’est pérenne ? C’est pérenne parce que c’est aussi une coproduction des trois instances citées. Ça nous permet de montrer qu’il n’y a pas d’un côté “les méchants” et de l’autre “les gentils”. Par contre, et je tiens à le souligner, il y a, dans la structure générale du pouvoir, une hiérarchie des responsabilités. La bourgeoisie est plus responsable que les deux autres instances dans le sens où elle a une puissance d’agir plus redoutable que les autres. L’État capitaliste est capitaliste car il est dominé par la bourgeoisie. L’État pour moi n’est pas une essence, il pourrait être dominé par le prolétariat. Mais il se trouve que depuis 400 ans, c’est le bloc bourgeois qui domine. C’est lui qui a le plus intérêt à l’organisation raciale de la société parce qu’il tire tous ses bénéfices, notamment de la structure raciale des rapports sociaux et de la division internationale du travail. Mais ça permet aussi d’identifier les autres responsabilités. Quand on jette un regard sur les organisations de gauche qui représentent l’opposition de classe à la bourgeoisie, on voit bien la contradiction de classe. La bourgeoisie exploite le prolétariat blanc. Il n’en reste pas moins qu’ils sont liés entre eux par l’impérialisme. Le prolétariat existe, vit et survit grâce, entre autres, à l’impérialisme, c’est-à-dire grâce aux rapports inégaux entre centres et périphéries. C’est ce qui permet de comprendre pourquoi les organisations de gauche qui représentent le monde ouvrier ont accepté le deal, le pacte racial, pourquoi elles sont si colonialistes et si blanches. C’est parce qu’elles font partie du deal, elles-même y participent. Ce que j’ai essayé de montrer avec ce livre c’est que la bourgeoisie a tout de suite compris qu’elle avait intérêt à gagner les classes populaires à son projet. Elle a réussi à universaliser ses propres intérêts. Ce faisant, ce processus crée une société civile avec des affects spécifiques qui lui sont propres. La bourgeoisie ne peut pas créer des bourgeois, ça voudrait dire cesser d’exploiter les prolos blancs et partager avec eux de manière égalitaire. Elle doit donc créer des blancs, et les blancs ne sont pas tous des bourgeois, loin de là. La bourgeoisie quant à elle n’a même pas besoin d’être blanche, ce n’est pas tellement important pour elle. Ce qui est important, c’est que le peuple soit blanc.
Azadî : Ça me fait penser à la bourgeoisie noire qui s’est créée aux États-Unis.
Houria : Bien sûr, et dans les pays du tiers-monde, ce qu’on appelle les bourgeoisies compradores. Cela dit, à l’échelle globale, les bourgeoisies du Sud se situent à un niveau inférieur parce que c’est quand même l’Occident qui est aux avant-postes de la domination capitaliste. C’est lui qui a le plus engrangé pendant des siècles et c’est lui qui a le plus accumulé. C’est donc normal que la plus grande bourgeoisie reste blanche, mais sa caractéristique n’est pas d’abord d’être blanche.
Azadî : C’est d’être bourgeoise. C’est pour cela que les grands pontes de l’Arabie Saoudite par exemple s’entendent plutôt bien avec les bourgeois blancs, qu’entre eux, il n’y a pas d’islamophobie ?
Houria : Oui et non. Quand on parle des Saoudiens, on est toujours méprisant. Le racisme ne disparaît pas. Il y a toujours un mépris profond vis-à-vis de ces « bédouins » qui se sont enrichis si rapidement, mais qui au fond restent de vulgaires bédouins grossiers et rétrogrades. Mais le rapport de classe atténue le racisme. Ce qui prime dans les relations, c’est le business.
Mariam : Rappelez-vous quand ils ont habillé Messi d’un bisht (cape traditionnelle considérée comme un signe de prestige dans certains pays arabes) pour la victoire de la coupe du monde et que les journalistes de BFM s’étaient moqués. Ils avaient appelé ça un peignoir, avec un air mesquin signifiant « c’est quoi ce truc de clochard ? »
Houria : Voilà, c’est ça. Ce mépris existe toujours. Quand tu vois ce médiocre Pascal Praud se moquer des Qataris, ça te donne une certaine idée de l’infinie arrogance occidentale.
Mariam : Dans le livre, tu insistes pour montrer à chaque fois les résistances de l’internationalisme ouvrier, de l’extrême gauche française. Des moments où elle a été anticoloniale. Tu les mentionnes fréquemment mais leurs efforts semblent souvent insuffisants ou faibles. D’où viennent ces résistances ? Et pourquoi n’aboutissent-elles pas ?
Houria : Les syndicats ont souvent été les plus téméraires. Ce sont ceux qui ont le plus persévéré dans la solidarité de classe. Le problème est qu’il n’y a pas que les syndicats, il y a les partis politiques. Le parti communiste par exemple. Il a longtemps été très puissant, mais il a été et reste très chauvin. C’est lui qui a influencé les syndicats puisque les syndicats comme la CGT étaient très liés au Parti communiste. Quand il y a eu la constitution du Front populaire, les syndicats ont dû en subir les conséquences. Ils peuvent avoir eu des velléités anticolonialistes mais les rapports de force sont aussi déterminés par l’existence d’une bourgeoisie industrielle et financière et par les grands choix des partis politiques. Quand tu es un syndicaliste et que tu dois déjà lutter pour les ouvriers qui travaillent en France, et qu’en plus tu dois arrimer ta lutte à celle de l’anti-impérialisme, ce n’est pas facile. D’une part parce que les rapports de force ne sont pas suffisants mais aussi parce que le monde ouvrier tel qu’il existe n’a pas cette conscience internationaliste qui lui permettrait d’y voir plus clair dans le fonctionnement du capitalisme. Les syndicats composent aussi avec leurs bases, donc avec une société civile qui est elle-même fabriquée par le consensus national.
Azadî : Tu expliques très bien l’avènement de l’État racial intégral, notamment à partir du triptyque « Liberté, Égalité, Fraternité ». Je pense que c’est un moment important du livre, car à travers la devise, tu expliques comment fonctionne le pacte racial. Tu dis « Blanc, le citoyen votera pour l’Empire. Français, le citoyen votera pour la préférence nationale-raciale. Individu, le citoyen votera pour ses intérêts propres et non pour ceux de son voisin ». Tu dis que la liberté a conduit à l’individualisme.
Houria : La liberté parce qu’elle était déjà déterminée par l’intérêt de propriété, soit la liberté de devenir propriétaire.
Azadî : Oui. À côté de la liberté, tu dis que la fraternité est perdue au sein du pacte racial. Tu t’interroges “est-ce que les damnés de la terre pourront appeler « frère » un blanc ?”. Dès la fin de la première partie, on comprend où tu veux en venir, redonner une part d’idéalisme à cette devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Houria : Oui, je voudrais la sauver parce que l’idéal révolutionnaire en son fondement est beau. Je ne veux pas jeter le bébé avec l’eau du bain.
Azadî : C’est aussi la devise qui a fait du mal aux peuples du Sud, avec le drapeau tricolore. C’est au nom de cette devise et du drapeau qu’on a prétendu civiliser le Sud. Et tu te le réappropries. Il y a une vraie symbolique puisque les blancs y tiennent, mais nous aussi on pourrait y tenir s’il y avait un vrai sens révolutionnaire dedans.
Houria : Tout à fait. En fait, ce sont de très beaux mots. Mais leur sens a été façonné par l’État racial intégral. Il n’en reste pas moins qu’au moment de la Révolution, il y a eu une possibilité pour que ces mots échappent au destin qu’on leur connaît aujourd’hui. Je me dis qu’il y a une possibilité d’y revenir. Il ne faut pas les laisser à l’ennemi et donc leur redonner un sens politique, un sens décolonial, anticapitaliste, antilibéral. Mais ce sera nécessairement l’objet d’une lutte.
Mariam : Tu termines sur la mémoire avec le chapitre « Le choix des ancêtres ». J’ai l’impression que, comme tu le disais au Bandung du Nord à Bruxelles, il manque à la gauche une Idée au sens de Badiou et que dans ce livre, tu essayes de participer à cette nouvelle Idée, à la rendre désirable. Et tu accordes donc beaucoup d’importance aux symboles et à la mémoire. Pourquoi terminer ton livre sur la mémoire, avec ce dernier chapitre dans lequel tu proposes un nouveau Panthéon, une réflexion autour du soldat inconnu ? Est-ce que c’était voulu dès le départ ?
Houria : Oui, c’était voulu depuis le départ, parce que je trouve que la politique de gauche en France est dénuée d’émotions, de sentiments et de sensibilité. Elle est sèche, trop matérielle, et Dieu sait si je tiens au matérialisme, mais ça ne suffit pas. Elle n’a pas d’âme. Je pense qu’il nous manque un souffle, il nous manque une Idée, il nous manque une transcendance.
Mariam : Et tu introduis ton livre par un hadith et par un extrait de la Bible. Quand j’ai vu ça, ça m’a fait sourire mais dans le bon sens du terme.
Houria : Bien sûr. Je commence par la nourriture de l’âme, ce ce qui nous fait tenir debout. Ce à quoi on tient le plus. Et ce qui paradoxalement nous est reproché dans la société française : qu’on ait gardé le sens du sacré. Rendre hommage aux ancêtres, c’est du sacré aussi. Dans la politique française, dans les mobilisations de gauche, le sacré n’existe pas. C’est aussi pour ça qu’elle est désertée.
Mariam : Il y a le registre de la dignité aussi que l’on retrouve dans les mouvements antiracistes, pas uniquement en France, mais aussi aux États-Unis ou ailleurs. Alors qu’à gauche, il y a moins cet intérêt pour la dignité. Certainement parce que les antiracistes sont plus sensibles à la dignité bafouée par le racisme qui déshumanise. Est-ce pour cela que c’est toi qui cherches à amèner cette sensibilité-là, en raison de l’histoire d’où tu viens ?
Houria : C’est vrai que la gauche ne se sent pas déshumanisée, alors que tous les indigènes se sentent déshumanisés. On a cette expérience qui nous détermine et oriente nos choix et nos affects.
Azadî : Tu t’inspires de Gramsci, de Poulantzas, de Lénine et enfin de Sadri Khiari. Comment ils t’ont aidée à développer ton sens de la stratégie politique, puisque ce qui les réunit, c’est qu’ils sont tous des stratèges politiques ?
Houria : Première chose, il faut reconnaître aux marxistes d’avoir fait le travail théorique sur l’État et le capitalisme, d’avoir déblayé le terrain et de nous avoir offert de grands outils d’analyse stratégiques et théoriques. Gramsci, Poulantzas sont incontournables. Lénine on n’en parle pas. Quand on a un tel leg théorique, ce serait une connerie de ne pas le valoriser. Sadri Khiari est un théoricien du Sud, qui vit sous l’impérialisme, c’est un Tunisien. Mais c’est aussi un marxiste, donc il a eu cette capacité d’articuler les luttes du tiers-monde avec le marxisme, ce qui a fini par se traduire par une œuvre décoloniale. Quand il est venu en France et qu’il a créé le Parti des Indigènes avec nous, honnêtement sans lui, nous n’aurions jamais eu les bases théoriques du Parti des Indigènes. Le PIR est lui-même le produit d’une rencontre, si j’ose dire, des beaufs et des barbares, en théorie. Puisqu’il y a l’apport du marxisme européen et celui des théoriciens du Tiers-monde. C’est Sadri qui nous a formés, à la théorie et à la stratégie politique. En tout cas, c’est lui qui m’a formée. Sans lui, en France, très sincèrement, il n’y a pas de théorie de la race. Attention, je ne parle pas ici de l’histoire coloniale à travers Césaire, Fanon et tous ceux qui ont fait le travail aux États-Unis. Dans le cas de la France postcoloniale, je pense qu’il n’y a pas de théorie de la race sans Sadri Khiari. Mais il reste très méprisé. Il n’est jamais cité. Tout simplement parce que le reconnaître, ce serait réhabiliter le PIR et ça, c’est haram.
Mariam : Sur la seconde partie du livre, dans le chapitre « Les mains sales » tu expliques la façon dont il faudrait saisir la part lumineuse des classes populaires, là où la gauche refuse de se salir les mains dès qu’elle doit faire face à leurs penchants réactionnaires ou jugés comme tels. Or, beaucoup se demandent comment saisir cette part lumineuse sans tomber dans une politique réactionnaire ?
Houria : D’abord, je propose un pari. Un pari est toujours risqué et le risque d’être emporté par la part réactionnaire existe. Mais en politique, on prend des risques. Ou alors, on n’en prend pas, on ne se salit pas les mains, mais on aura grandement contribué par notre lâcheté à laisser le terrain à la partie adverse. Par ailleurs, pour moi se salir les mains, ce n’est pas qu’une théorie, c’est aussi une pratique. Aux Indigènes de la République, je peux donner des exemples où on a su sublimer la part lumineuse des indigènes. On a su séparer la part lumineuse de la part sombre. Je donne un exemple que j’ai vécu. Au début des années 2000 après la deuxième intifada, de nombreuses manifestations ont eu lieu en France. L’antiracisme politique n’existait pas, et les mobilisations étaient essentiellement organisées par la gauche blanche, les communistes, la CGT, jusqu’à la LDH (Ligue des droits de l’Homme). Leurs mots d’ordre étaient très mous. Mais les indigènes dans les quartiers étaient très en colère, enragés, mais exclus du champ politique, exclus de la gauche. Ils avaient besoin d’exprimer leur rage, et comme ils n’étaient pas canalisés politiquement, qu’il n’y avait rien pour les représenter, pour les construire, c’étaient souvent leurs bas instincts qui parlaient. Leurs bas instincts étaient parfois anti-juifs. Et la gauche le savait et avait peur de voir les indigènes débouler et salir ses manifs. Et effectivement quand ils venaient, il y a eu assez souvent des débordements antisémites. À cette époque-là, des militants comme Youssef Boussoumah qui faisaient partie des grands fronts en solidarité avec la Palestine devaient organiser des services d’ordre pour virer les indigènes susceptibles de faire du tort à la cause palestinienne en criant des slogans antisémites. Youssef coursait des gens dans les manifs, il les virait à coup de tatane. Il faut comprendre qu’au nom de la cause palestinienne, il était d’une importance supérieure que les manifestations soient irréprochables. C’était le chantage de la gauche pour qu’elle daigne se mobiliser. Les conditions étaient posées selon ses termes à elle. Or, les Palestiniens, faute de mouvement de masse anticolonialiste et indépendant de la gauche, avaient besoin du soutien des organisations blanches. Plus il y avait des débordements, plus la gauche abandonnait la Palestine. Les anti impérialistes comme Youssef devaient faire le sale travail au nom de la cause.
C’est alors que l’antiracisme politique est né. Il a radicalisé les mots d’ordre, il a d’abord assumé son antisionisme. Il soutenait les mouvements de résistance quelle que soit leur obédience, le Hamas par exemple. Il légitimait la lutte armée des Palestiniens en faisant des parallèles avec l’Algérie, l’Afrique du Sud mais aussi la Résistance française. Les gens dans les manifestations avaient le droit de venir en tant que Musulmans. Ça c’était nos manifs à nous. On a élevé le niveau de radicalité et on a rencontré l’affect indigène. Les indigènes venaient en masse dans nos manifs. Par exemple lors des manifs monstre de 2009 et 2014. C’était nous à l’avant poste, nos slogans antisionistes et radicalement dénués d’antisémitisme étaient repris en cœur. Dans nos manifs, curieusement, tous les excès indigènes se sont résorbés. Parce qu’ils arrivaient chez nous, et on leur disait « vous avez le droit de venir en tant que vous-mêmes », « vous avez le droit d’être antisioniste ». Ils ne pouvaient pas être plus radicaux que nous. Du coup, la surenchère antisémite n’avait plus lieu d’être puisque le besoin de radicalité était assouvi par notre propre radicalité. Elle a même disparu. Dorénavant, les « incidents » antisémites, faute d’exister, il a fallu les inventer comme ce fut le cas en 2014 où Manuel Valls a monté une affaire antisémite de toute pièce.
Mariam : Plus besoin de faire des provocations antisémites donc…
Houria : Plus besoin ! Leur rage s’exprimait dans les mots de l’antisémitisme parce que la gauche était molle. Elle n’était pas capable d’exprimer quelque chose à la hauteur de leur colère et de l’événement. Alors qu’avec nous, les gens se sont moulés dans nos mots d’ordre. Et ça leur suffisait. Et là, c’est la part lumineuse qui est apparue, à savoir un anticolonialisme sincère et profond, tandis que le sentiment antijuif disparaissait petit à petit.
Mariam : On voit l’importance du travail politique de traduction. Tu sais que l’antisémitisme des indigènes cache en réalité un antisionisme que tu décides de politiser pour mieux lutter pour la Palestine et contre l’antisémitisme.
Houria : Voilà. Le paradoxe de tout ça, c’est que les antisémites, il y en avait dans les manifs de la gauche molle mais pas dans les manifs indigènes au final. Parce que le travail de politisation a été fait chez nous. Ça a été fait dans un espace de quinze ans, ça a été long, mais si tu regardes les manifestations interdites à Paris il y a deux ans, il y a plein de jeunes qui sont sortis et tout le monde s’accorde à dire que les slogans, pourtant spontanés du fait de l’interdiction des manifs, étaient nickels. Quand les gens ont le droit d’être antisionistes, ils n’ont pas besoin d’être antisémites. Ce qui montre que l’équation antisioniste = antisémitisme est une vaste escroquerie. On peut même se demander si ceux qui jouent sur cette équivalence ne cherchent pas à augmenter le niveau d’antisémitisme plutôt que de le résorber.
Azadî : J’ai l’impression que ce que tu viens de dire est une mise en abyme de ce qu’a été le PIR et de ce que tu représentes : avoir les mains sales et permettre aux personnes d’exprimer ce qu’elles veulent exprimer, mais en leur donnant un bagage politique pour les protéger.
Houria : C’est-à-dire qu’on fait tout pour empêcher l’ensauvagement des indigènes, l’antisémitisme étant une forme d’ensauvagement. On a tenté d’enrayer cette mécanique. Ce n’est pas gagné, mais c’est dans cette direction qu’il faut continuer à travailler. Ça nécessite des organisations prêtes à se salir les mains. A la lumière de cette expérience, je suis convaincue que c’est ce qu’il faut faire avec les classes populaires blanches. Il faut sublimer la part lumineuse des beaufs et des barbares.
Azadî : Tu cites dans ce nouveau livre ce passage de ton premier livre, Les Blancs, les Juifs et Nous : « Si les choses étaient bien faites, le devoir des plus conscients d’entre vous serait de nous faire une proposition pour éviter le pire. Mais les choses sont mal faites, c’est à nous que cette tâche incombe ». Je me demande pourquoi c’est encore à nous de faire le pari du nous ?
Houria : Soit on le fait, parce qu’on n’a pas de temps à perdre. Soit on s’assoie, et on attend que la gauche le fasse. Voilà. Il faudra s’armer de patience parce qu’elle n’est pas prête à se salir les mains. En attendant sa prise de conscience, nous, on fait notre taf, et elle, elle avancera à son rythme qu’il faudra accélérer si on en a les moyens.
Azadî : Avancer à leur rythme ça me fait penser à quand tu dis dans le livre qu’il va falloir composer avec les blancs qui n’aiment que leurs enfants. On en revient toujours au Nous. Au sein du Nous, il y a deux vitesses, deux affects différents.
Mariam : Et même des sous-vitesses avec des sous-groupes au sein de ces classes populaires.
Azadî : Comment avancer avec des rythmes différents, comment unifier des camps qui eux même ne sont pas unifiés en leur sein ?
Houria : Moi je ne vais rien faire du tout. Je n’ai pas la capacité d’unifier les indigènes ou d’unifier les blancs. Il y a trop de contradictions matérielles et historiques pour que je puisse faire quoi que ce soit. Je ne suis pas une magicienne. On trace des lignes stratégiques et théoriques. Le travail d’unification sera un travail politique de toutes les parties en présence, de toutes celles qui voudront bien s’engager dans cette direction. Nous, on aura notre part de travail en tant qu’embryon décolonial. Ce travail d’aller chercher les indigènes. Et c’est le paradoxe de l’affaire, ce travail doit souvent passer par les blancs. En politique, il y a des moments. Peut-être que le moment est celui qui consiste à avoir comme priorité de convaincre les blancs. C’est un travail politique. Parfois, il s’agit de convaincre les blancs pour qu’avec les indigènes, nous puissions aller plus vite. Le moment où je parle, on l’a dit hier dans l’émission sur l’antiracisme politique, on est dans le creux de la vague. Il y a un travail qui est en train d’infuser. Si on me dit que ce sont surtout les blancs qui sont intéressés par mon livre, je dis tant mieux. C’est quoi le problème ? La marche de 2019, pourquoi autant d’indigènes sont sortis ? Parce qu’il y avait des « grands blancs », Mélenchon et Martinez notamment. Il y a deux choses qui font sortir les indigènes en masse : les grands blancs qui rendent les manifs légitimes et sécurisantes où le sang : celui qui gicle à Gaza ou l’assassinat de Georges Floyd. Ce n’est pas nous qui les faisons sortir, nous sommes au mieux les cadres organisateurs en capacité de capter le moment et de lui donner une direction. Ça fait 15 à 20 ans qu’on lutte contre l’islamophobie, on n’a jamais fait sortir 30 000 ou 40 000 personnes dans la rue. Il a fallu la participation des grandes organisations blanches qui rassurent et rendent l’acte désirable et « rentable ». Mais pourquoi les grands blancs ont-ils fini par nous rejoindre ? C’est grâce au travail politique des indigènes. C’est donc aussi grâce à l’antiracisme politique que ces mêmes grands blancs ont pris conscience du rôle de l’islamophobie comme idéologie contre-révolutionnaire, mais de manière indirecte. Comme d’habitude, les choses sont dialectiques.
Azadî : Tu parles aussi des abstentionnistes. Tu dis qu’il y a les abstentionnistes qui sont indifférents, contrairement aux autres qui penchent davantage vers le racisme. C’est le bloc abstentionniste qu’il faudrait inclure dans le pari du nous ?
Houria : Chez les blancs, je vise effectivement les abstentionnistes, parce que finalement, je les trouve intéressants. Il y a une offre qui leur est faite, qui est celle du racisme et du RN, et ils n’y cèdent pas. Je les trouve bien ceux-là ! Il faut absolument aller vers eux car on sent qu’il leur manque une offre. Ils sont prioritaires. L’autre cible est ceux qui votent à gauche, qu’il faut maintenir au maximum dans nos rangs. Et parmi ceux qui votent extrême droite, je vise ceux qui ont voté Mélenchon (ou divers gauche) au premier tour, et Le Pen au second. Eux sont aussi très intéressants. Ce serait bête de les abandonner au vote RN puisqu’ils ont d’abord fait un choix de classe. Ceux qui votent Le Pen premier et second tours, on ne les calcule pas. On n’est pas désespérés à ce point.
Azadî : Je voulais que tu parles des apartés parce que je les trouve extrêmement beaux, très touchants, et en lien avec ce que tu écris. Nous en tant que lecteurs ça nous fait du bien, mais toi est-ce que ça t’a aidée parfois à sortir du théorique ? Parce que dans tes écrits, il y a toujours une forme de poésie.
Houria : Pour moi, les apartés, c’est du supplément d’âme. Mais c’est aussi la chose que je ne veux pas décrire de manière analytique. Par exemple, il y avait un manque dans mon livre. C’était la manière dont on se mélange avec les blancs. Comment on vit vraiment ensemble, je veux dire, concrètement. On est un pays de métissage en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est métissé. Mais je ne voulais pas faire une analyse de sociologue, ça méritait un traitement différent. Tout un chapitre là-dessus ça n’a pas beaucoup d’intérêt en soi. Je voulais plus un traitement émotionnel. Il y a un truc qui est clair, il y a une barrière infranchissable, c’est la barrière de classe. Les riches, ils se reproduisent entre eux, et tu ne peux pas te mélanger avec. Je veux dire que les grands blancs ne veulent pas se mélanger avec les petits blancs. Par contre, petits blancs et indigènes, en veux-tu en voilà, des métisses. Ça veut dire que la barrière de la race, dans les faits, se franchit. J’ai trouvé que ça méritait un traitement à part. On a des enfants. Ils sont bien là. Et ils disent l’alliance possible des beaufs et des barbares mieux et plus que mille mots.
Mariam : Eugénie Bastié a lu ton livre et est l’une des premières journalistes à avoir écrit un article dessus, dans le Figaro (« Dans la tête d’une révolutionnaire racialiste »). Elle « analyse » ainsi « Les beaufs et les barbares doivent s’allier contre un ennemi commun, le grand blanc capitaliste et l’État racial. C’est l’alliance du faucille et du Coran, de la lutte des races et de la lutte des classes. ».
Houria : Si Eugénie Bastié avait un minimum de culture politique, elle saurait que cette expression, « l’alliance de la faucille et du Coran », vient de son propre camp, de la droite. C’est son camp qui a eu peur de l’alliance des ouvriers blancs et des ouvriers indigènes. Ce sont eux qui ont transformé une lutte ouvrière indigène en lutte islamiste. Ce sont leurs mots, pas les miens. Ensuite, j’ai trouvé cet article moins délirant que ce que j’ai pu lire parfois sous la plume de journalistes de gauche. J’ai relevé aussi sur Facebook qu’elle dit que je ne parle pas de l’antisémitisme de Soral. Je crois bien qu’avec le PIR, on a été les premiers à dénoncer l’alliance de Dieudonné et de Soral fondée entre autres sur l’antisémitisme. Soral me déteste pour ça, parce qu’on l’a dénoncé à maintes reprises. Je me demande comment elle fait pour l’ignorer. Si elle a vraiment lu mon livre, elle ne peut pas ignorer le passage où je dis que l’idéologie de Soral relève de l’antisémitisme. C’est une menteuse. Elle n’est ni la première, ni la dernière. Depuis Bastié, Le Point et Charlie Hebdo lui ont emboîté le pas. Ils sont tellement nuls, qu’ils ne méritent pas qu’on s’y attarde.
Azadî : Tu dis souvent que la classe bourgeoise est celle qui a la plus grande conscience de classe. Eugénie Bastié dit justement : « Beaucoup voudraient faire taire Houria Bouteldja. Je pense qu’il faut la lire au contraire, car sa pensée racialiste est en train de gagner les esprits. D’ailleurs, elle-même se vante du butin de guerre que constitue Mélenchon, acquis à la pensée indigéniste. La gauche est en train de faire le pari de l’islamo-marxisme dont elle est la prêtresse ».
Houria : Mais je vais la contredire. Nous on ne racialise pas, on déracialise. Je répète, c’est son camp qui a transformé les ouvriers immigrés qui revendiquaient des droits sociaux et politiques en islamistes. C’est comme ça qu’on racialise les rapports sociaux. Mélenchon quand il s’attaque à l’islamophobie, il déracialise. Eric Ciotti, pareil, il m’a fait rire parce qu’il s’offusque avec l’extrême droite du fait qu’on dit qu’il y aurait un « suicide français ». Le thème du suicide français est un thème d’extrême droite. Ce sont eux qui disent que la France se suicide. Eux ont le droit de le dire, mais quand nous on fait éventuellement les mêmes constats, mais avec des analyses différentes et pour des objectifs différents, tout d’un coup ça ne va plus. On n’a pas le droit de dire qu’il y a un suicide français au sens culturel où pour moi, les identités modernes sont façonnées par la marchandisation, l’individualisme. Il y a une distinction très forte entre ma position et celle de l’extrême droite parce que l’extrême droite considère que les identités sociales et historiques de la France disparaissent à cause de la massification de l’immigration, de l’Islam etd ‘un projet de « grand-remplacement ». Moi, je dis que s’il y a une disparition historique des cultures locales, c’est à cause de l’émergence des États-nation, du capitalisme, et de l’impérialisme. Il y a plus de chances que la France soit menacée d’américanisation que d’islamisation, ou d’africanisation. C’est ça le véritable grand-remplacement. Ce sont aussi deux dynamiques complètement différentes parce que l’américanisation, c’est vider une culture de sa substance pour ne garder que le caractère consumériste. Tandis que l’africanisation, c’est juste un mélange de culture, c’est un enrichissement qui nous apporte quelque chose, qui nous apporte des dimensions spirituelles, culturelles. Qui nous apporte une autre manière de voir et donc qui ne peuvent qu’enrichir le substrat français, qui s’est toujours enrichi de par son histoire et depuis le début, comme toute culture. Toute culture est faite d’emprunts et de mélange. Il n’y a pas une culture algérienne stricte et homogène. On est tous le fruit de l’histoire complexe. Donc ce qui arrive à la France de par son histoire et notamment de par son histoire coloniale, c’est que les autres cultures viennent et se mélangent à l’existant. Quand les immigrés viennent, ils ne laissent pas leur culture au porte-manteau, pour rentrer dans la classe, dans la grande nation France, tous nus, pour être francisés selon une norme définie par l’État. Ils entrent dans la classe avec leur manteau, avec leur histoire, leur mémoire, et ils partagent leur culture. Pour moi, partager la culture, c’est ma mère qui faisait le couscous pour les voisins. On ne va pas devenir des névrosés comme les gens d’extrême droite. Quelqu’un qui veut partager quelque chose avec moi, sa baguette par exemple, eh bien je l’accepte, je suis très contente quand on m’offre un bout de baguette et un bout de fromage.
Rire : si on finit la dessus, on va m’accuser d’essentialiser les Français qui ne sont pas réductibles au cliché de la baguette et du fromage. Allez, je prends le risque !
Pour le QG décolonial, Azadî et Mariam
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 459 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
23/02/2026 - 11:14
23/02/2026 - 11:08
19/02/2026 - 10:00
13/02/2026 - 09:44
BBC Afrique
05/02/2026 - 21:08
Commentaires récents
"Ils volent l'argent des Martiniquais !"
DETOURNEMENT...
Albè
25/02/2026 - 11:28
Vous détournez carrément le sens de cet article : Il dit pourtant clairement que OUI, la France d Lire la suite
"Ils volent l'argent des Martiniquais !"
"L'argent des Martiniquais" ?...Pfff..démagogie !
yug
25/02/2026 - 10:27
Excellent article !!! Lire la suite
Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique : ouvrages de Sciences Naturelles, médecine, pharmacopée, agronomie, météorologie, vulcanologie et écologie
CARAIBEDITIONS fait lui aussi...
Albè
24/02/2026 - 19:40
...des rééditions et en nombre. Lire la suite
Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique : ouvrages de Sciences Naturelles, médecine, pharmacopée, agronomie, météorologie, vulcanologie et écologie
@Lidé bonjour. Je comprends...
Frédéric C.
24/02/2026 - 15:25
...votre souci. Mais parfois il est difficile de se procurer certains ouvrages. Lire la suite
Le Niger et l'Algérie main dans la main
yug-hitler dans ces oeuvres!!!!!!!!!!!!!
@Lidé
24/02/2026 - 11:30
Menteur, de mauvaise foi!
Pour Thiaroye, vous aves des sources?
Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- "Ils volent l'argent des Martiniquais !"
- Affaire de "la retraite illégale" de Serge Letchimy : un bien curieux jugement
- Sur la traduction créole de la nouvelle de Guy de Maupassant Le rosier de madame Husson, (Vié gason man Isson-an) par Francine Narèce et Roland Davidas
- Guadeloupe, Guyane, Haïti, Martinique : ouvrages de Sciences Naturelles, médecine, pharmacopée, agronomie, météorologie, vulcanologie et écologie
- Cracking the code of Papua New Guinea’s undocumented languages
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus





