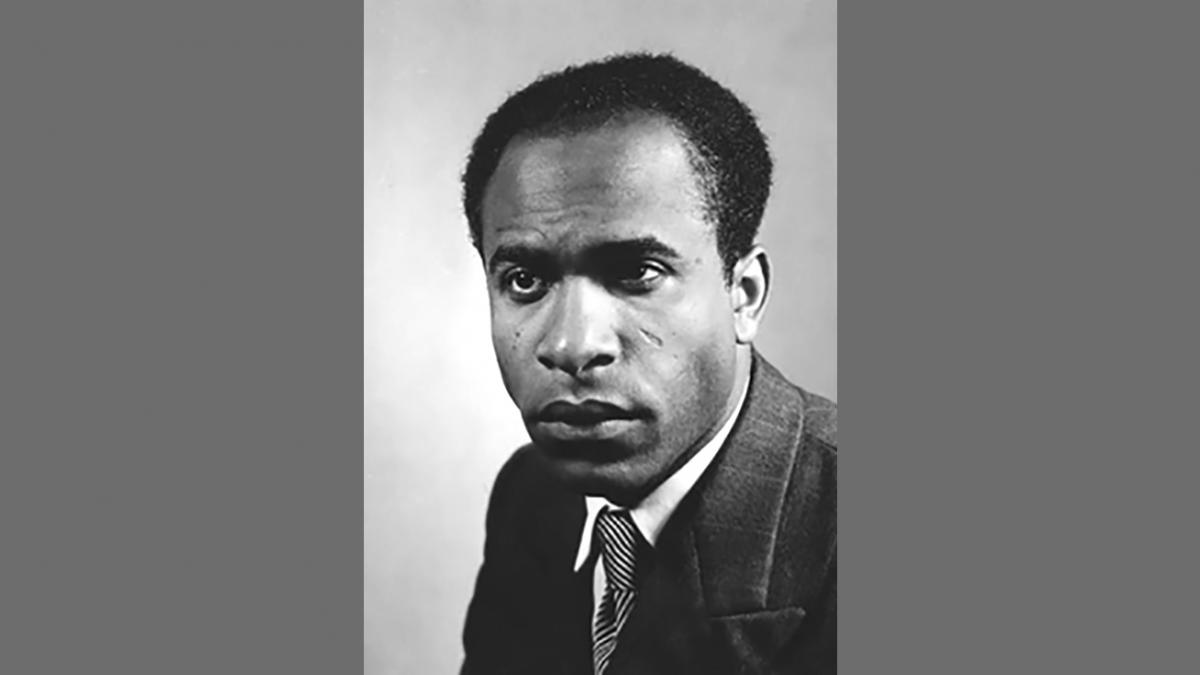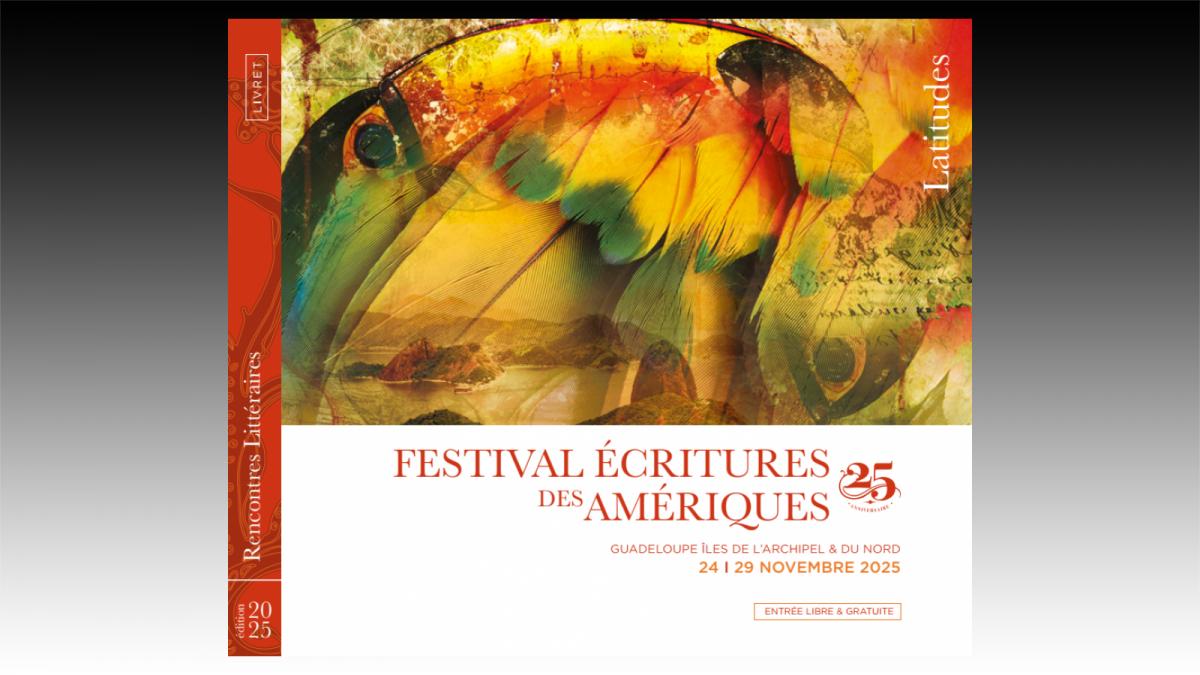Mohamed Mbougar Sarr a-t-il vraiment gagné le Goncourt ?
Houria Bouteldja ("QG Décolonial")

La malédiction du Goncourt va-t-elle s’abattre sur lui comme elle s’est abattue en 1921 sur René Maran, premier Goncourt noir de l’histoire ? Le tollé, avait eu raison de Maran qui démissionna de son poste d’administrateur colonial alors que son roman n’avait même pas eu l’audace de condamner le colonialisme, seulement ses excès. Le personnage, que Fanon avait qualifié de « frileux » n’était certes pas un foudre de guerre, mais il avait posé une pierre.
Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Mohamed Mbougar Sarr, lui, n’est pas « frileux ». Qu’on en juge :
« Universels ! Ah, l’universalité…Une illusion tendue par ceux qui la brandissent comme une médaille. Ils la mettent autour du cou de qui ils veulent. S’ils la mettent autour du vôtre, c’est pour vous prendre. (…)Brûlez les médailles. Et les mains qui les tiennent. Arrachez les derniers lambeaux de l’ère coloniale et n’attendez rien ! Au feu toutes ces vieilleries ! A la braise, à la cendre, à la mort ! »
Il ne mâche pas ses mots pour dire ce que Maran n’avait pu dire. Il dit tout, sans fausse pudeur et sans détour. Il dit tout et il le dit avec talent. Tout du malaise de l’écrivain noir balloté entre la reconnaissance des siens et la mainmise des Blancs :
« Nous avions ensuite longuement commenté les ambiguïtés parfois confortables, souvent humiliantes, de notre situation d’écrivains africains dans le champ littéraire français. Un peu injustement, et parce qu’ils étaient des cibles évidentes et faciles, nous accablions alors nos aînés, les auteurs africains des générations précédentes : (…) nous les accusions de s’être laissé enfermer dans le regard des autres, regard-guêpier, regard-filet, regard-marécage, regard-guet-apens … ». Il dit vraiment tout, même les reproches que ses frères lui font : « Voilà pourquoi tu ne seras jamais reconnu ici : tu nous snobes. Les Blancs peuvent te célébrer autant qu’ils veulent, te donner tous les prix qu’ils veulent, parler de toi dans leurs grands journaux, mais ici t’es rien. Nada. Et quand t’es rien chez toi, t’es rien nulle part. T’es un aliéné, un Nègre de Maison ».
Difficile de penser que le lauréat du prestigieux prix littéraire ne serait qu’un simple faire-valoir francophone des cercles parisiens en mal de diversité. Pourquoi cette élite se complairait-elle à saluer une plume qui les humilie et les déshabille ? Aurait-elle enfin abdiqué de sa morgue hautaine pour s’incliner, défaite devant un chef d’œuvre ? Nous sommes tentés de le croire. L’écrivain a du talent et le snobisme germanopratin semble avoir été pris par surprise. Le génie l’aurait alors emporté ? On pourrait se satisfaire de cette interprétation qui nous parait plausible mais la petite voix nous dit que ce n’est pas tout. Ça ne peut pas être tout. Impossible.
Commençons par ce qui semble une évidence. Pourquoi celui qui écrit : « L’adoubement du milieu littéraire français. C’est notre honte, mais c’est aussi notre gloire fantasmée, notre servitude et l’illusion empoisonnée de notre élévation symbolique » trahit-t-il ses personnages (dont on comprend qu’il sont ses doubles) avec autant de désinvolture en acceptant le Goncourt avec une fierté presque gênante ? Il aurait pu faire le choix de leur donner vie, prolonger le geste de l’œuvre, pour que la fiction déborde et vienne submerger le réel. Une critique juste et intransigeante pourrait légitimement lui faire ce reproche. Mais elle serait idéaliste et raterait l’essentiel. A y regarder de plus près, il se pourrait que derrière le sacre de Mohamed Mbougar Sarr se soit jouée une partie plus tortueuse qu’il n’y paraît.
Et si nous faisions l’hypothèse que ce prix n’est que le pendant culturel et médiatique d’un événement politique d’importance : le sommet Afrique-France de Montpellier où se sont cristallisés de nouveaux rapports de forces entre la puissance coloniale déclinante et une Afrique plus rebelle et moins dépendante ? En effet, les deux évènements semblent se faire écho dans une espèce de symétrie troublante. Ils disent un moment de la France dans son rapport à ses dépendances coloniales. Souvenons-nous des paroles de Boubacar Boris Diop : « La France n’a plus l’envergure d’un Etat en mesure de soutenir un tête-à-tête avec tout un continent, aussi malheureux soit-il[1]. » Si Macron s’agite, s’il copine avec Achille Mbembe, s’il s’ouvre à une certaine critique de la Françafrique, c’est que celle-ci prend l’eau. Cependant, quoi qu’il arrive aucun président français digne de ce nom ne prendra le risque de tuer la poule aux œufs d’or. A la dernière grand’messe de Montpellier, c’est encore Macron qui a pris le dessus mais non sans difficulté face à une Afrique de plus en plus infidèle.
Relisons le Goncourt à la lumière de ce timide rééquilibrage.
D’abord, il fallait privilégier les symboles. Macron avait tenu à honorer la jeunesse africaine lors du sommet de Montpellier. C’est aussi un jeune sénégalais de trente ans que le Goncourt décide de récompenser. Ensuite, Macron exigeait de cette jeunesse une parole de vérité. « On ne me met pas assez la pression ! Mettez-moi la pression ! » a-t-il ordonné à Achille Mbembe. La plume de Mohamed Mbougar Sarr n’est-elle pas trempée dans l’acide ? N’a-t-il pas fait « pression » sur le milieu littéraire ? Enfin, il faut agir. Macron a validé la proposition de Mbembe d’une « Maison Maryse Condé des mondes africains et des diasporas » à Paris. Le jury du Goncourt a célébré le sacre d’un authentique écrivain. Décerner des prix de complaisance à des indigènes médiocres devenait en effet embarrassant et ça commençait à se voir.
Mais la partie se joue à deux. Et qui dit rééquilibrage des forces, ne dit pas équivalence des forces. Loin s’en faut. En l’état actuel des choses, ni les peuples d’Afrique dans un contexte international, ni Mohamed Mbougar Sarr dans le contexte feutré des salons parisiens ne peuvent prétendre imposer leur regard. C’est pourquoi les personnages fantasmés du livre n’ont pas pu prendre le dessus. C’est pourquoi Mohamed n’a pas pu les incarner et c’est pourquoi il a servi aux membres du jury un discours lénifiant sur l’importance de la francophonie et sur ces écrivains africains francophones en mal de reconnaissance. Celui dont le personnage criait : « Brûlez les médailles. Et les mains qui les tiennent », remercie obséquieusement ceux qui le font entrer dans la légende. Pascal Bruckner, membre du jury et auteur des « sanglots de l’homme blanc », brûlot de la littérature anti-tiers-mondiste, est en pamoison. Ils ont trouvé un héros d’une envergure impressionnante qui pourrait les écraser par son simple talent mais il n’en fait rien. Ils viennent de dompter un lion avec une facilité déconcertante. C’est ce qu’on peut appeler une belle prise.
Fin de partie ?
Peut-être pas. Derrière la façade du discours, il est un sous-texte. La francophonie n’appartient plus à la France mais à ses millions d’Africains qui transforment la langue, la réinventent, la triturent. La France est une province. C’est en dehors de ses frontières que la langue se réinvente. Mohamed Mbougar Sarr confirme l’intuition de Kateb Yacine : Le français ne serait-il pas un butin de guerre ? Finalement, ce roman qui dit tout haut ce que Mohamed pense tout bas, n’est-il pas un braquage en règle, le geste d’un romancier qui évalue finement les rapports de forces et saisit toutes les règles du jeu littéraire, sans tout à fait s’y soumettre ? Quelqu’un qui a su manipuler la mauvaise conscience blanche en sa faveur ? Peut-être que l’originalité de la situation c’est que les raisons politiques qui ont poussé le jury à le choisir sont dans l’œuvre elle-même ? Il écrit un livre qui dit en substance « vous êtes des salauds » mais il le fait avec un talent d’écriture qui écrase largement le petit monde littéraire parisien. Ce faisant, il les oblige à le consacrer car c’était le seul moyen pour eux de sauver ce qu’il leur a révélé d’eux-mêmes. C’était le seul moyen de reprendre le dessus sur une œuvre faite pour les humilier. Résultat : ils reprennent le dessus (tout comme Macron) mais l’œuvre reste un affront (tout comme les infidélités croissantes de nombre de dirigeants africains).
On pourrait se lamenter et regretter que Mohamed Mbougar Sarr ne soit pas vraiment le Mohamed Ali dont nous rêvons. Mais ce serait oublier que ce dernier était un être collectif et qu’il était porté par l’effervescence des luttes noires. Dans le désert politique indigène français, qui aurait sauvé Mohamed Mbougar Sarr des hyènes qui l’auraient déchiqueté ou condamné à la déshérence s’il avait fait le choix héroïque de la rupture ? N’est pas Sartre – qui avait le privilège du prestige et de la blanchité – qui veut. Quel est le prix littéraire en Afrique qui aurait pu rivaliser avec le Goncourt et sublimer le geste rebelle ? Qui en indigénat aurait eu le pouvoir de faire du jeune prodige, un écrivain ?
Mohamed Mbougar Sarr ne le sait que trop bien : « Voilà notre triste réalité : le contenu misérable de notre rêve misérable, la reconnaissance du centre – la seule qui comptât ».
Pour l’instant. Parce que si vous observez bien, à la cérémonie de remise du prix, il y a avait des applaudissements mais aussi beaucoup de sourires crispés.
Houria Bouteldja
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 80 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Mustafa Benfodil ("El Watan.dz")
14/12/2025 - 10:42
Yves Tusseau
04/12/2025 - 11:09
Julien Steinhauser
02/12/2025 - 19:47
26/11/2025 - 17:28
Commentaires récents
L'antisionisme se paie cash, ma belle !
A L'HEURE OU DES DESCENDANTS DE NAZIS...
Albè
15/12/2025 - 20:43
...sont élus présidents triomphalement comme au Chili, que des fachos comme Millei en Argentine, Lire la suite
L'antisionisme se paie cash, ma belle !
Indirectement, l’article...
Frédéric C.
15/12/2025 - 18:07
...parle de l’antisionisme. Lire la suite
L'antisionisme se paie cash, ma belle !
BLANCHE MACHIN...
Albè
15/12/2025 - 17:02
...n'est pas le vrai sujet de cet article. Lire la suite
L'antisionisme se paie cash, ma belle !
2 "sketches" de B.Gardin prouvant de quel côté elle est;
Frédéric C.
15/12/2025 - 16:43
L'antisionisme se paie cash, ma belle !
HOU LA !
Albè
15/12/2025 - 12:34
Me dit pas que t'es de la même trempe que Babette de Rozières ou Christine Kelly ! Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- L'antisionisme se paie cash, ma belle !
- Municipales en Martinique : première campagne électorale "sous réseaux sociaux"
- L’imposture idéologique et méthodologique de l’économie mainstream
- Les îlots Matthew et Hunter au cœur d’un conflit entre la France et le Vanuatu
- « Tu viens de Tahiti à Paris en pirogue ? » : cette autrice tord le cou aux clichés sur les Français d’outre-mer
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus