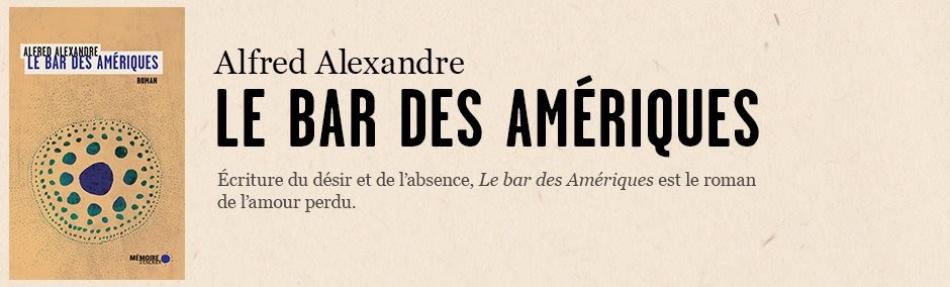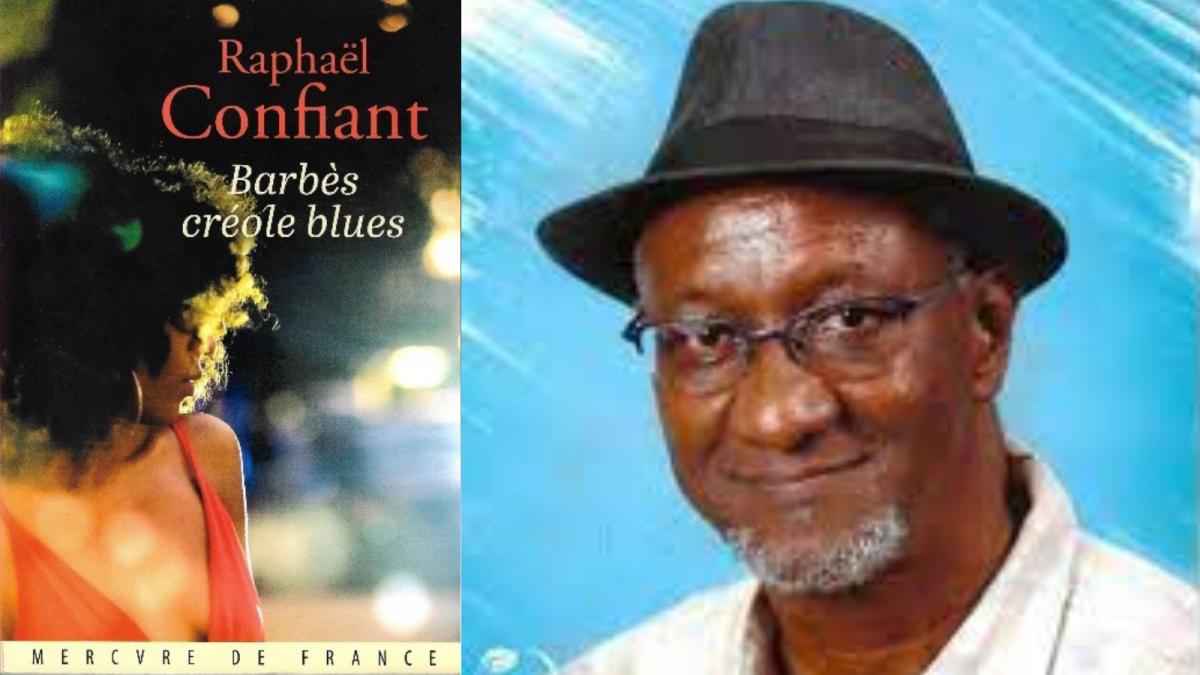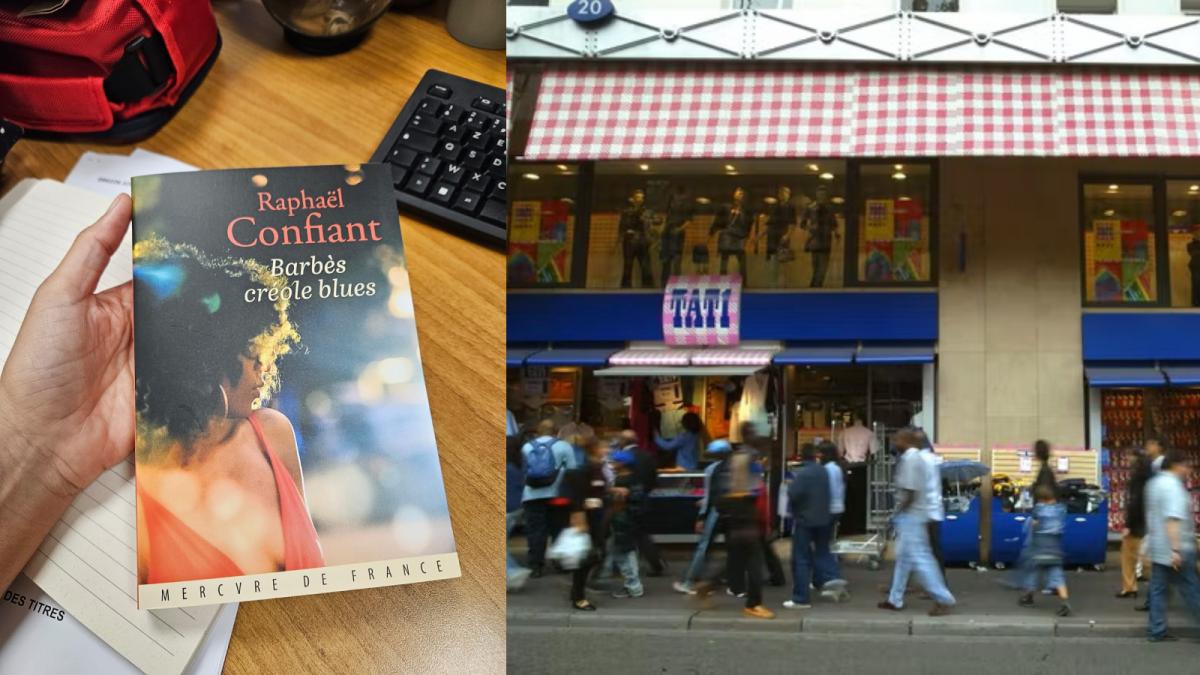Des damnés sous le soleil des Amériques

LE BAR DES AMÉRIQUES, roman-poème paru en 2016, (Éditions Mémoire d’encrier), a stupéfié les participants de la soirée littéraire de l’ASCODELA. C’est un brûlot sans concession, une bouteille contenant un liquide acide jetée à la mer, un témoignage d’une radicalité définitive, une « littérature des cicatrices ». Les îles de cet univers géographique particulier sont bafouées tout autant que les corps et les âmes. Clandestins, migrants, ou natifs, « ivres comme à la mer, une bouteille en la dérive », paraissent condamnés à une longue drive des esprits, « d’autant plus folle qu’elle était condamnée à ne jamais vouloir se nommer elle-même ».
L’auteur, Alfred ALEXANDRE, a fait des études de philosophie à Paris. Né en 1970 à Fort-de-France, il vit en Martinique où il exerce la profession d’enseignant-formateur. Son premier roman Bord de Canal a obtenu le « Prix des Amériques insulaires et de la Guyane » en 2006. Il a également abordé le théâtre. Il a publié un essai sur CESAIRE « la part intime » en 2014.
La dimension d’universalité archétypale du triangle amoureux
Le personnage féminin, Bahia, est murée depuis trente ans dans une douleur indicible. Il semble qu’il s’agisse d’un amour perdu. Elle a dérivé d’île en île, au sens propre comme au sens figuré, puisqu’elle aurait même été enfermée dans un conteneur, sur un des multiples bateaux qui parcourent la mer Transcaribéenne, jusqu’à ce quelle croise Leeward ( ou le retrouve). De toute évidence, le conteneur est une métaphore de l’enfermement, tout autant que l’île, et que la presqu’île, mais a été tout autant « et sa prison intérieure et son refuge le plus profond ».
Mais serait-ce lui, son premier amour, comme elle le prétend, qui n’aurait pas hésité à la jeter, trente ans auparavant par dessus-bord suite à l’intervention des garde-côtes ? N’aurait-elle pas évoqué jusqu’au désespoir ce souvenir qui, vague après vague, lui « revenait comme un mauvais baiser » ? N’est-elle réapparue, (mais est-ce bien elle ), que pour affronter cet épisode douloureux ? « Bahia répétait comme le refrain d’une chanson, que c’est pour un pas de danse qu’elle était descendue de sa chambre, qu’elle avait une dernière fois mis sa robe à paillettes, Pour qu’il la fasse à nouveau danser »… Car c’est dans ce même hôtel qu’elle aurait dansé pour la première fois avec Leeward il y a trente ans. « Et c’est voile immobile qu’ils allaient Bahia et lui vers leur dernière noce, vers leur Finis Terre ». Pour que surgisse enfin leur Terre Neuve ?
En quatre carnets d’une langue triturée, déchiquetée, hallucinée, (même à l’excès selon une intervenante), Hilaire fait revivre le triangle amoureux qu’il a formé avec Leeward et Bahia. Il ne cache pas que lui, l’ami de toujours, a usé en certaines occasions comme un charognard du corps de Bahia. Mais sa quête d’amour était bien plus que charnelle. Pour nous lecteurs, ces épaves humaines seraient cantonnées à une misère sexuelle et à des pulsions primaires. Au contraire, Bahia devient le miroir révélateur du moi secret et des interrogations existentielles d’Hilaire.
« C’est ça que j’avais toujours voulu moi aussi. C’est ce qui m’avait toujours fait rêver… Moi aussi, me dégoter un petit carreau de terre. Au bord de l’île. Pour pouvoir, le soir, sous le vent, asseoir mes crasses sur la véranda et regarder, de loin la mer allumer des ombrages sous les soleils virant de l’oeil.
Même si ce genre de noces tranquilles, tout contre moi, ça n’avait jamais vraiment fait partie de ses horizons ordinaires.
Tout ce qu’elle voulait, Bahia, c’était qu’on prenne un verre, un autre encore, et puis encore Boire… Bahia… Boire. Jusqu’à se retrouver dépossédée de son propre corps,
Et elle lançait alors, en ricanant, comme une épave, que ça ne servait à rien, les antidotes et les poisons qu’elle avait cru, amant après amant, un jour, pouvoir changer en leur contraire.
C’est comme ça qu’elle parlait, Bahia. Au réveil, après l’amour. Nue et neuve en effet. Nue et saoule à la fois. … C’est comme ça qu’elle vivait, Bahia. Entre la nuit et le jour. Entre alcool et mémoire. Entre appel aux tendresses et grandes frappes de haines ».
Pourquoi évoquer une littérature des cicatrices ?
Cette expression provient d’un mouvement littéraire apparu en Chine, à la fin des années 1970, et qui suivit la Révolution Culturelle. Beaucoup d’écrivains ont alors exorcisé un passé marqué par le réalisme-socialisme et la littérature officielle, (qu’on pourrait comparer peut-être aux chantres de la négritude ), en offrant une vision crue et directe de la société.
Elle sera le fait d’écrivains confrontés aux mythes des décennies passées, (en l’espèce mythes des indépendances ou exaltation de figures héroïques), et contraints à reconstruire la réalité et la vérité à partir de leur propre vécu.
Alfred ALEXANDRE nous lance à la figure « que le pays n’avait plus les yeux pour voir où habitait sa véritable tragédie contemporaine, Acharné qu’il était, sur injonction lapidaire de ses maîtres historiques et de leurs servants décérébrés, à ne se réclamer que des catastrophes du passé, pour ainsi s’interdire d’avoir à nommer les faillites du jour qui s’ouvre et les assassins, qui, chez nous, dansaient comme des carnavalesques au-dessus de nos dépouilles vidées de leur cervelle ».
Les faillites politiques, et économiques concernent d’ailleurs toutes les îles de la Caraïbe, quels que soient leur statut, et leur histoire. Les puissances ex-coloniales se désintéressent des îles, et sont prêtes à les abandonner, n’en déplaise aux indépendantistes et autonomistes de tout poil qui s’agitent . Elles ont bien d’autres moyens de pression. « Notre pays depuis longtemps aura cessé d’être tenu en laisse par celui qui garde dans sa poche les titres de propriété et le drapeau dont les trois couleurs défraîchies flottent à vide dans le vent ».
Mais s’agissant plus particulièrement des Départements français
« Les îles qui se croyaient françaises… le pain au prix de la dépendance, elles aussi… C’est comme ça qu’ils nous voyaient, dans l’archipel, les salopards… dans ces pays qui suaient pour exister d’eux-mêmes, qu’ils nous enviaient et nous méprisaient, dans le même temps.
Le mépris… pour cette dépendance honteuse, car si totale, qu’il s’acharnait, chaque fois qu’on accostait en pays voisin, à nier, Leeward, derrière des fiertés incrédules, des récits de révolte en papier mâché, des identités de consolation, toujours plus vainement, toujours plus doctement revendiquées ».
Nous ne pouvons pas passer sous silence que cette charge au vitriol trouve une résonance particulière, avec les querelles récentes sur les dates de commémoration de l’abolition de l’esclavage.
Et que dire du développement économique, qui est une totale mascarade ? « Derrière nos soi-disant artisanats de pêche au gros et à miklon. C’est ça, hein, qui avait fini par devenir notre religion ? Comme tous ces pseudo-capitaines d’industries qui avaient réussi à se remplir les graines dans nos pays. Mais faire passer, d’une terre à l’autre, le boudinement des macaqueries et des matières qui donnaient aux pauvres, et à leurs grands et petits bourgeois décalebassés, l’illusion jouissive qu’ils étaient devenus, eux aussi, des opulents »
Cette littérature exprime une vision sombre du présent et de l’avenir. On peut la qualifier de «négative »
Quel contraste avec par exemple Cahier d’un retour au pays natal qui évoquait, malgré la lucidité du constat césairien « Au bout du petit matin bourgeonnant d’anses frêles, Les Antilles qui ont faim, Les Antilles grêlées de petite vérole, Les Antilles dynamitées d’alcool », le jour qui se levait, la foi du poète en la fin de la longue nuit, et en un avenir meilleur.
Ici, rien de tel. La vision de l’auteur est une dégénérescence physique et morale que rien ne paraît contrebalancer. « Jusqu’à ce que la nuit nous raye de l’existence ». La déchéance alcoolique est prégnante. Même transfigurée par le prisme de la fiction narrative, la seule figure féminine apparaît , nous l’avons signalé, comme « ricanant comme une épave ». Mais tout autant sont fustigés la « jactance autocentrée et indécrottablement contente d’elle-même, tout ce vomi dans nos esprits, la mort lente comme une tumeur dans le cerveau », « le grand bizness bringuebalant, dans ses soutes impunies, des mafias inconnues chez nous jusque-là… Pour prendre possession des îles, et une fois encore, les réduire en colonies… en bars à pute ou s’enivrer de sa puissance revigorée »
En effet, de par leur positionnement entre l’Amérique du Nord et du Sud, les îles de la Caraïbe sont un lieu idéal de trafics, « Où se lotissent les ateliers et la litanie verte des clandestins ».
Les mafias internationales, les organisations criminelles règnent en maîtres sur la Transcaribéenne. Elles sont les héritières des compagnies qui possédaient les îles, il y a cinq siècles, et auxquelles les trafiquants de drogue et les passeurs –les nouveaux trafiquants d’esclaves-- prêtent allégeance.
Cette Transcaribéenne, la mer caraïbe, n’est-elle plus qu’une simple ruée des conteneurs au travers du canal de Panama alors que se dessinent d’autres projets encore plus pharaoniques ?
« La crevasse, elle sera mille fois plus grande encore, avec tout en travers de Panama, l’excavation, en grande largeur de cette troisième saignée à la veine grande ouverte pour le passage presque immobile de ces nouvelles générations de méga porte-conteneurs ».
Drogue, drague, dieu
Nous avions eu le Sea, Sex, Sun. Nous aurons dorénavant Drogue, Drague, Dieu*.
Dans ce chapelet d’îles baignées par la Transcaribéenne, les existences et les territoires sont broyés par les puissances anciennement colonialistes qui paraissent impuissantes face au commerce de la drogue, et laissent s’installer les sectes, qui déversent « les sermons que braillaient, à se péter les veines du cou, les télévangélistes qui émettaient un peu partout aux Amériques et que Leeward, le matin comme le soir, écoutait déblatérer à la télé », et les usines de sexe.
Parce que jamais les dieux, ah ça non, ne s’étaient si bien portés dans la région. Il suffisait, pour s’en rendre compte , de soupeser la flopée éternelle de culs bénis qui, chaque jour, un peu plus, essaimait pour vanter la foi à régénérer et les apocalypses, qui, selon eux, se dégonçaient jusu’à nos îles mal verrouillées par les prières, qu’on dansait à moitié nus… Ivres du tambour de nos divinités plusieurs fois malfaisantes.
Tout l’archipel, du nord au sud, pullulait sous les cantiques, le démonisme et l’espérance en une nouvelle terre grasse.
Il pouvait lancer, oui, qu’avec les clandestins, les cames, le cul : le bizness des sacrements, c’était devenu un des plus gros trafics de l’archipel. L’un des plus grands bars à fesses de l’Amérique.
Entre une virée de nouveaux missionnaires, les Écritures sous le bras, courant les îles en chemise blanche amidonnée, pantalon bleu tergal… les fillettes, les garçonnets ou les corps plus matures… la photo de charmes sur la plage aux cocoteraies dormant à l’ombre des soleils, ou bien les vidéos de viol réel ou simulé à diffuser sur l’Internet.
Mais même ce que nous pensions être une des composantes remarquables de nos sociétés antillaises, le respect des morts ne trouve pas grâce aux yeux de l’auteur.
Nos pays ont le goût des fêtes mortuaires… Mais s’en foutent du mort… Ce qu’ils aiment, c’est le théâtre sacré… les processions de linge blanc… le cérémonial de chants plaintifs… et l’odeur de l’encens. Moi je ne veux rien de toutes ces chienneries-là. Juste un trou dans le sable… au bord d’une crique.. Ah ça non, laisse personne me barricader dans nos cimetières de ville. C’est des villes concentrées de lumière, surchargées de magie.
Le style employé est hautement émotionnel
Les expériences sentimentales et charnelles sont une sorte d’océan qui submerge le sujet.
Le cycle hermétique des répétitions intensives, la régularité du rythme sous-tendent l’idée de ressassement, comme la construction particulière des phrases dont on recherche sans cesse la fin. Comme le mouvement sans fin de la mer?
L’espace narratif est démantelé
L’écriture subjective, dans la littérature chinoise contemporaine, est caractérisée par l’omniprésence du narrateur, qui par ses multiples interventions, rompt l’illusion du récit. De même, Hilaire passe son temps à se questionner, à s’interpeller, à nous interpeller. Le temps et l’espace narratif se fragmentent.
La confusion des temps, des mots, des histoires, « Elle, Leeward, moi, le bar, la presqu’île et tout ce qui depuis trois semaines ou trente ans, souvenir après souvenir, nous avait amarrés l’un à l’autre », nous désoriente. Les cartes sont sans cesse rebattues. Bahia est-elle une création romanesque ? Sa présence dans l’hôtel est-elle attestée ? Les événements narrés se sont-ils passés, il y a trois jours, ou trois mois, ou trente ans, ou proviennent-ils d’une imagination troublée ? Seul Hilaire pourrait nous le dire.
Notre seule certitude est que la quête du bonheur et de l’amour est bien le moteur des relations des personnages composant ce trio.
Alfred ALEXANDRE nous offre un superbe exercice de style, doublé d’une réflexion sans indulgence sur nous-mêmes…
La quête de l’individu a remplacé le chant collectif.
La recherche compulsive de l’autre est omniprésente. Ces êtres perdus et rejetés expriment à leur façon leur rêve d’une féminisation de la société.
L’écriture se met au service de la féminité (l’île et la femme).
L’île « close en sa barrière de sables et de sels » en introduction du deuxième carnet, est apaisée au quatrième carnet « Comme par-delà le temps, réconciliée, l’île seule l’île soeur ». Cela suggère un rapprochement des peuples de la zone caraïbe, par-delà leur diversité. Mais surtout que nous ne détournions plus notre regard des supposés rebuts de nos sociétés, criminels et prostitué(e)s qui revendiquent également leur part d’humanité.
[*Triptyque composé par le rédacteur de l’article]
Alfred Alexandre
LE BAR DES AMÉRIQUES
Roman
Éditions Mémoire d’encrier, 2016
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 46 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Mohammed Aïssaoui ("Le Figaro littéraire")
05/03/2026 - 09:07
04/03/2026 - 08:52
09/02/2026 - 20:16
Commentaires récents
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
PARCE QUE TU T'IMAGINES...
Albè
09/03/2026 - 19:30
...une seule seconde que j'ai tenté d'alphabétiser bun crétin de ton espèce ????! Lire la suite
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
Négro blanc raciste humanitaire vivant sous tropiques froids .
yug
09/03/2026 - 18:32
Je te rassure sur mon identité :
Lire la suiteDerrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
PARASITE 1er
Albè
09/03/2026 - 18:11
...autrement dénommé "YUG" (l'un de ses multiples pseudos lui servant à éructer ses âneries dans Lire la suite
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
Yug-hitler= intello?
@Lidé
09/03/2026 - 17:16
le temps long est le la matière des anthropologues (ce n'est pa son gros mot, hein!!!!!?)
Lire la suiteDerrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
Yug-hitler= intello?
@Lidé
09/03/2026 - 17:09
le concept temps n'est pas d'albè mais de fernand Braudel historien français, de plus
Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- T'es géniale, Naïka, mais fais attention aux racailles et autres rappeurs opportunistes !
- Tout goudron, tout béton et l’on s’en fout du rhum Neisson
- Non, les Martiniquais ne sont pas du tout assimilés aux Gaulois !
- Agression Israélo-yankee contre l'Iran : ne pas se laisser manipuler par les médias !
- Kémi Séba explique "l'extraversion des économies africaines"
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus