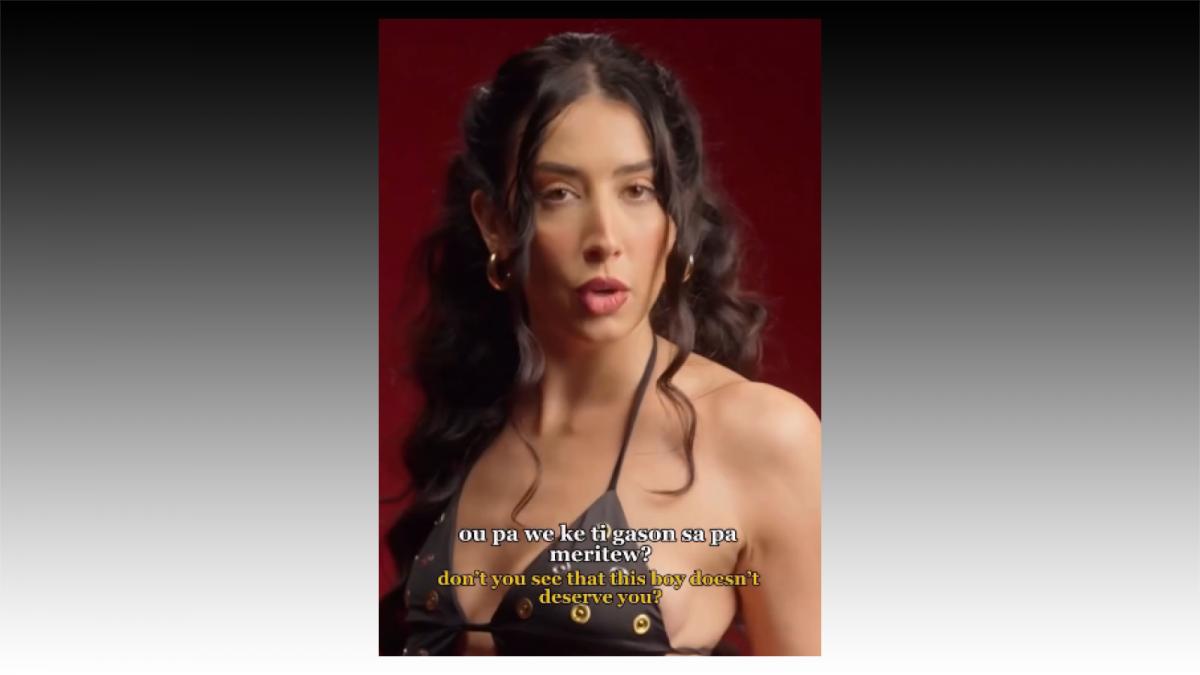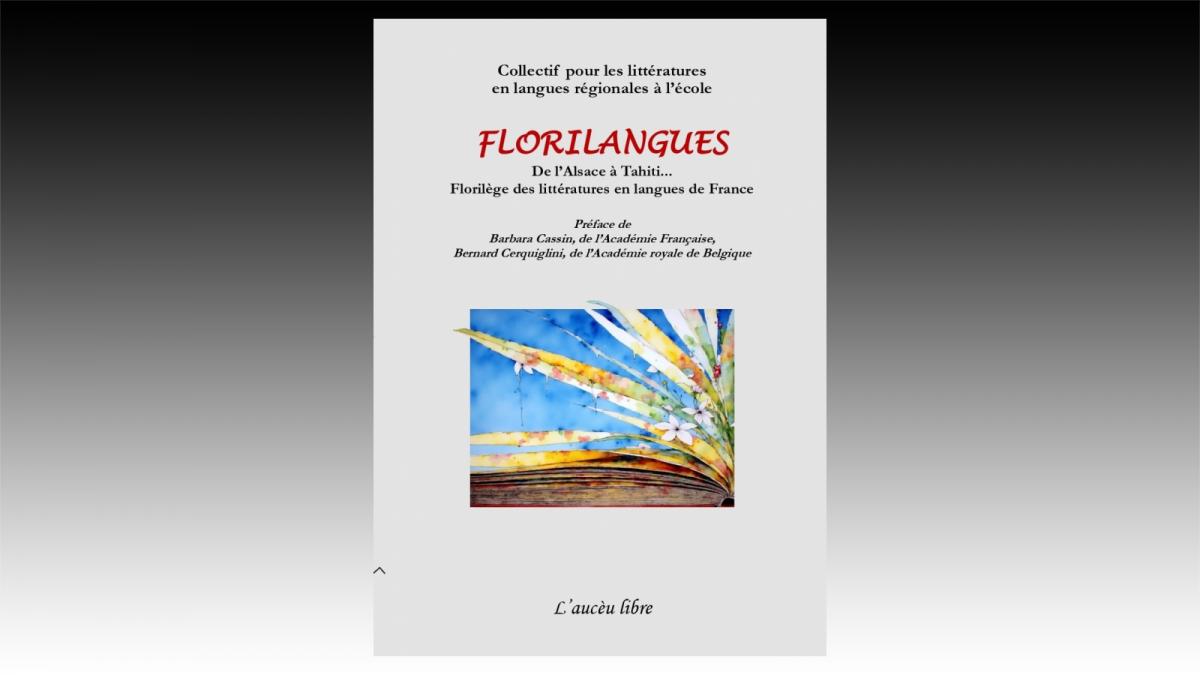Entretien avec Ryōko Sekiguchi : « Je ne pourrais jamais être l’écrivain d’une seule langue »

Olivier Sécardin s’entretient avec Ryōko Sekiguchi au sujet de ses années d’apprentissage – entre le Japon et la France – et de son métier de traductrice, d’une langue à l’autre.
Vous êtes née à Tokyo, le 21 décembre 1970 et depuis 1997, vous vivez à Paris. Les lecteurs français vous connaissent bien, avec un rythme de publication au moins annuel et des écritures très diverses, depuis la poésie – Cassiopée Peca ou Adagio ma non troppo – jusqu’au récit autobiographique ou à l’essai – par exemple, la Voix sombre – nourrit de vos expériences, de vos deuils et de vos voyages, même si vous restez par ailleurs très discrète dans vos annotations. C’est d’ailleurs une qualité remarquable de votre écriture qui est capable de livrer une sensibilité sans impudeur. Avant de parler du métier d’écrivain et du « corps de traducteur » – vous dites que l’acte de traduire est devenu « peu à peu la colonne vertébrale » de votre travail, que seule la traduction traverse véritablement tout ce que vous faites – j’aimerais vous poser quelques questions sur vos années d’apprentissage ainsi que sur votre parcours professionnel.
Le quartier de votre enfance est le quartier animé de Shinjuku. Tōkyō est une ville qui change si vite ; il est difficile d’imaginer ce quartier dans les années 80.
À cette époque, Shinjuku était aussi un quartier littéraire avec ses éditeurs, ses relieurs, ses imprimeurs. Pour s’imaginer Shinjuku, il faut changer d’échelle. Shinjuku n’est pas un quartier au même titre qu’un quartier de Paris, comme le sont le Marais ou Saint-Germain-des-Prés. C’est un arrondissement tellement vaste qu’il engloutirait plusieurs quartiers de Paris. La zone la plus connue de Shinjuku est bien-sûr le quartier de la gare avec ses hommes d’affaires en transit mais il y avait aussi à cette époque d’autres quartiers très différents, vivant selon des rythmes propres et des gestes spécifiques et notamment là où habitaient mon grand-père et mon père, toute une vie liée aux métiers de l’édition.
Quand j’étais enfant, mon père travaillait dans une entreprise de fournitures de bureau : chaises, bureaux, papeterie, c’était son univers. Ma mère ne travaillait pas, elle était femme au foyer. Plus tard, elle est devenue cuisinière et enseigna la cuisine.
J’ai vécu avec un petit frère de 3 ans de moins que moi, qui vit toujours au Japon et qui travaille maintenant dans une entreprise d’import-export de papier. C’est drôle, on peut dire que toute la mythologie familiale s’est construite autour de l’idée de remplir des pages blanches : mon grand-père était éditeur, mon grand-père paternel travaillait dans une usine de papier, et moi, entourée de papier et de livres, je suis devenue écrivain.
L’oncle de mon grand-père maternel avait fondé une petite maison d’édition qui s’appelait Nihon Shoin, qui du reste publiait essentiellement des manuels scolaires et des cartographies. Quand mon grand-père est rentré du front, son oncle lui a proposé de travailler avec lui. Plus tard mon grand-père a décidé de publier des revues littéraires. Malheureusement, sa maison d’édition a fait faillite. Ce n’était pas un drame, il était à la fin de sa carrière. Ce qui lui importait, c’était d’exaucer son rêve. Il avait la passion des livres.
Vous dites que ce rapport au grand-père qui est si essentiel est aussi source de conflits familiaux. Vous racontez que votre grand-père maternel vous a initié à la lecture, en tous les cas plus que ne l’a fait votre propre père. Quel rapport avez-vous alors aux livres et à la lecture ?
Il y a deux familles. Mon grand-père maternel – téruo ôtsuka – était éditeur et consacrait sa vie à la littérature, donc d’une certaine façon à la recherche esthétique et aux vies singulières. La famille de mon père était plutôt du côté du droit, des procédures réglées, des rôles établis et de l’ordre – une famille de notables plutôt que de littéraires. Vous savez, d’un côté le plaisir de lire et d’écrire ; de l’autre, le langage figé des normes, la reconduction de l’ordre. D’ailleurs mon père disait toujours que les filles ne devaient pas lire. Avant d’être une activité complétement normalisée, lire a donc d’abord été une sorte de transgression familiale. Et même si aujourd’hui je taquine mon père en lui disant que ses principes éducatifs n’ont pas toujours été appliqués à la lettre puisque je suis devenue écrivain – les enfants font toujours ce que les parents ne veulent pas – rétrospectivement, je dois reconnaitre que les possibilités même de lire et d’écrire n’étaient pas si évidentes après tout. Mais il y avait mon grand-père et ce grand-père était heureux de m’offrir des livres ; aujourd’hui encore je lui en suis reconnaissante. À la librairie, il me disait : « prends tout ce que tu veux » et le rituel s’est poursuivi jusqu’à mes 22 ans.
Vous écrivez que votre grand-père voyait en vous « l’incarnation de celle qui pouvait réaliser son rêve, écrire ». Quel rapport, lui, avait-il à la lecture et à l’écriture ?
Quant au plaisir de lire, je me demande quelle part je dois à mon grand-père : m’a-t-il appris à aimer lire ou bien l’amour que je lui portais m’a-t-il fait aimer ce que lui-même aimait ? Je ne sais pas trop. J’étais tellement fière de mon grand-père. En tous les cas, concrètement et symboliquement, il est indissociablement lié au plaisir de lire. C’est aussi quelqu’un qui voulait écrire, qui désirait écrire mais qui n’y arrivait pas. Je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir écrire pour lui.
Enfant puis adolescente, quelles sont les lectures qui vous marquent le plus ?
J’ai beaucoup lu pendant mon enfance, plutôt de la littérature de jeunesse occidentale un peu « old school », des œuvres traduites comme Mary Poppins de Pamela L. Travers, Little House Books de Laura Ingalls Wilder, Winnie the Pooh d’Alan Alexander Milne ou Les Mille et Une Nuits en version abrégée. En tous les cas, je lisais toujours de la littérature étrangère traduite. Grâce à ces lectures, j’ai très vite compris l’idée même de la traduction, j’en ai même eu pour ainsi dire la conscience. Pour un enfant, comprendre que le texte qu’il lit est traduit, qu’il n’a pas d’abord été écrit dans sa langue maternelle, est une expérience très intrigante. La prise en considération de l’idée même de traduction permet de considérer un ailleurs et d’imaginer d’autres lecteurs.
Je me souviens par exemple qu’au cours de ma lecture de Little House Books – il y avait sept ou huit tomes en tout – l’éditeur a changé de traductrice et à mon grand désespoir la nouvelle traductrice a voulu traduire les aventures de la famille Ingalls dans un japonais rustique, très campagnard. J’avais huit ans et ça ne me plaisait pas du tout. Ce n’était pas du tout l’image que j’avais de cette famille. Évidemment, le destin d’une famille du Wisconsin puis du Dakota du Sud à la fin du XIXe siècle ne ressemble pas tellement aux jours ordinaires d’une famille japonaise des années 80 mais c’est la force des récits de nous confronter à d’autres vies que les nôtres. C’est aussi de cette façon que j’ai pris conscience pour la première fois des différences culturelles et du pouvoir de la traduction.
Ce n’est pas commun de prendre conscience de la médiation des traducteurs dans les processus de transmission des textes à cet âge.
C’est pourtant ce qui m’a le plus marqué. C’est ce que j’ai senti ou plutôt ressenti très tôt – et qui m’a ouverte aux nuances de l’interculturel. Je me souviens des moments de doute et même de résistance quant à la signification de certains mots et de certaines choses imagées. Quand je lisais qu’on désignait un enfant par « mon petit lapin », je me disais : « mais d’où vient ce lapin ? », « de quoi s’agit-il ? ». J’ai mis du temps à comprendre car il n’y a pas d’expression équivalente en japonais. C’est un détail mais ce sont justement les détails qui règlent et qui dérèglent l’activité interprétative. Ce sont comme de petits cailloux dans les chaussures du lecteur-traducteur. D’ailleurs, ces différences qui à la fois enrichissent et stressent l’interprétation apparaissent plutôt en périphérie qu’au cœur même du texte, si bien qu’on pourrait, à la limite, ne pas y prêter attention. Pourtant, le trésor de la langue s’offre précisément en ces occasions, dans les appellations, les idiolectes, les interjections, les manières de saluer, etc.
Je n’ai jamais pensé que la diversité des langues permettait simplement de désigner diversement les mêmes choses, elle permet surtout d’offrir des points de vue différents sur ces choses. Prenez un mot tout simple, un mot comme « bonjour ». Dire « bon jour » ne dit pas exactement la même chose que le latin vale – qui signifie porte-toi bien – ou que l’hébreu shalom ou que l’arabe salam (que la paix soit avec toi). Chaque langue est une façon différente de se représenter le monde et d’y vivre. C’est pourquoi le défi de la traduction est de réussir à faire communiquer ces mondes.
Ces considérations m’ont fait penser que même un livre adressé aux enfants doit savoir garder ses difficultés interprétatives pour la raison simple qu’il ne faut jamais taire la voix de l’étranger.
Vos propos me font penser à ce que dit Barbara Cassin dans Plus d’une langue quand elle écrit que le bilinguisme est une chance car c’est une chance de savoir qu’il existe plus d’une langue, que la langue maternelle n’est pas la seule langue possible et d’abord qu’une langue, comme toute chose dans la vie, ça s’apprend. Après, toute la question est de savoir comment passer d’une langue à une autre… Mais dans ce que vous dites ici, j’entends aussi beaucoup de résonnance avec le projet d’une littérature monde à la façon d’un Glissant, d’un Raphaël Confiant ou d’un Patrick Chamoiseau. Par ailleurs, vous avez traduit Solibo Magnifique (Subarashiki Solibo, aux éditions Kawade Shobô Shinsha), qui a reçu le Grand Prix de la traduction japonaise en 2016.
Les textes de Chamoiseau sont des textes extrêmement singuliers, très difficiles à traduire car ils empruntent des expressions créoles, mélangent des dialectes, inventent des néologismes. Or cette inventivité répond à la fois à une situation historique – ces écritures finissent par écrire un texte dont le contenu est effectivement le produit de plus d’une culture, de plus d’une langue et de plus d’un monde – et à un choix politique. Pour un traducteur, c’est presque comme s’affronter à la traduction d’un texte multilingue. Comment ne pas effacer l’hétérogénéité linguistique au moment de la traduction ? Mais comment aussi ne pas perdre le lecteur qui ne dispose pas nécessairement des connaissances pour comprendre et apprécier l’extraordinaire inventivité de cette langue ? C’est pour cela que la traduction est une activité chaque fois singulière et pour ainsi dire entreprise au cas par cas : j’ai fait mon deuil d’une grande théorie universelle de la traduction depuis longtemps. Ce que je veux dire, à travers cet exemple ou celui de la littérature de jeunesse, c’est qu’un traducteur ne doit pas trop effacer les traces d’hétérologie. J’insiste : les enfants ne sont pas des lecteurs moins compétents que les autres et ce ne sont certainement pas des barbares. Un livre traduit adressé aux enfants doit savoir garder ses propres difficultés interprétatives pour ne pas taire la voix de l’étranger.

© Léopold Chauveau, Paysage monstrueux, n°55, 1921
Revenons aux textes de votre enfance et de votre adolescence. Un livre vous a-t-il particulièrement marqué pendant cette période, un livre qui serait plus qu’un livre, un livre relu sans cesse ?
Un livre m’a beaucoup impressionné, d’un auteur français très connu au Japon mais personne ne semble le connaître en France. C’est Léopold Chauveau. Chauveau était chirurgien mais aussi écrivain, dessinateur-illustrateur de livres de jeunesse et sculpteur autodidacte. Dans les années 30, il devint l’ami de Roger Martin du Gard. Au Japon, il est lu et traduit à chaque fois par des romanciers. Peut-être parce que les récits de Léopold Chauveau, adressés aux enfants, donnent envie de les traduire. Kōji Yamamura a même adapté son Histoire du vieux crocodile. Chauveau écrivait pour son fils mort, plutôt des récits extraordinairement ingénieux, avec des contraintes quasi-oulipiennes. Par exemple, un récit qui commence par la fin et qui termine par le début. Et à chaque fois ce sont des histoires à la fois formidables et drôles, pas du tout moralistes, accompagnées de dessins incroyables, un peu comme Alice aux pays des merveilles.
L’année dernière, le musée d’Orsay a organisé une exposition sur cet auteur. Malheureusement, l’exposition a été confinée. Chez Chauveau, on retrouve toute une époque : des jeux de mots, un esprit de révolte, la peur de la guerre et le spectre des morts. Ses monstres ne sont guère effrayants mais en même temps ils font quand même penser aux invalides et aux blessés de guerre.
Votre histoire familiale – votre père qui s’inquiète de vos lectures et de vos ambitions littéraires – dit aussi l’histoire sociale du Japon et sa politique « familialiste » quant au maintien d’attitudes traditionnelles en matière de répartition des rôles familiaux et professionnels. À cette époque, en tant que jeune femme et jeune femme de lettres, percevez-vous déjà distinctement les contraintes sociales qui pourraient empêcher votre carrière littéraire ?
On peut même dire que le Japon est une société foncièrement patriarcale. Ce fut ma chance et mon malheur. Sinon je ne serai pas parti du Japon. Mais si je n’avais pas eu cette chance de pouvoir partir – ce qui est le cas de beaucoup de gens, j’aurais probablement cessé d’écrire. Je n’étais pas issue d’une famille suffisamment riche pour écrire sans en faire un métier et mon père ne voulait pas que j’aille à l’université. J’ai passé le concours de son université en cachette et j’ai réussi mais j’ai refusé d’y aller. Je suis allée dans une autre université. Quand j’ai reçu un prix littéraire à 17 ans, mon père n’était pas content. Quand j’ai été reçue à l’université de Tokyo, ce qui aurait dû être une fierté pour la famille, il m’a dit que je n’allais pas trouver de mari… Aujourd’hui, on n’empêche pas les jeunes filles d’aller à l’université mais la récession est aussi passée par là : le Japon ne peut plus se permettre de refuser le travail aux femmes. Seules les classes sociales les plus aisées peuvent se permettre de rester à la maison, sinon il faut travailler et gagner sa vie. Mais si on regarde la représentation politique des femmes au Japon, c’est catastrophique, pire que l’Iran…
Vous quittez donc le Japon assez jeune, j’imagine pour vos études ?
Je suis partie en France à l’âge de 19 ans, essentiellement pour l’apprentissage de la langue. Entre 20 et 21 ans, j’ai vécu à Nancy pour mes études puis j’ai vécu entre la France et le Japon avant de m’installer définitivement en France en 1997. J’ai commencé par étudier l’histoire de l’art à la Sorbonne puis, à l’université de Tokyo, j’ai commencé un Doctorat dans la section de littérature et culture comparées, plus particulièrement en histoire de l’art comparée. Mon sujet de recherche portait sur la modernisation et l’institutionnalisation de l’art au Japon et dans les pays maghrébins. Miura Atsushi, professeur à l’Institut d’Art et de science à l’université de Tokyo, a été mon directeur de recherche. Ses travaux portaient sur l’histoire de la peinture française du XIXe siècle et sur les échanges artistiques entre la France et le Japon. Malheureusement, je n’ai pas fini ma thèse et j’ai arrêté mes études pour me consacrer pleinement à l’écriture.
Votre carrière est précoce. En 1988, à l’âge de 17 ans, vous obtenez le prix des Cahiers de la poésie contemporaine. Pouvez-vous me parler de ces poésies ?
Au Japon, pour débuter une carrière d’écrivain, on n’envoie pas directement son manuscrit chez l’éditeur comme on le fait en France. Chaque maison d’édition a sa revue et organise une fois par an un concours. De cette façon, les maisons d’édition collectent et lisent les manuscrits qu’elles peuvent récompenser par un prix et bien-sûr repérer les jeunes talents à cette occasion. Ce sont ces prix qui permettent d’initier une carrière dans les lettres et de publier chez un éditeur en tant que « professionnel ». C’est un système assez efficace pour les maisons d’édition et assez satisfaisant pour les jeunes écrivains. Dans mon cas, cette pratique m’a encouragée très tôt à écrire pour des lecteurs plutôt que pour moi – quand on est jeune, on a tendance à écrire pour soi plutôt que pour les autres – et c’est encore plus vrai maintenant que j’écris en prose.
Mes premiers poèmes étaient très formalistes. Je m’imposais des contraintes quasi-oulipiennes, sans même connaître les auteurs de l’Oulipo. D’ailleurs, je ne connaissais pas encore le français à cette époque. En outre, le formalisme littéraire n’était pas du tout à la mode au Japon. Je dois reconnaître que j’ai eu beaucoup de chance : qu’une jeune femme propose des poèmes formalistes aux règles compliquées et que personne ne comprend, ce n’est pas forcément ce qui est le plus apprécié au Japon. Il y a même une expression assez péjorative pour désigner ce type de travail jugé trop intellectuel – du moins pour les femmes, pas nécessairement pour les hommes.
Votre recueil de poésie Cassiopée Peca (1993 puis 2001) m’a fait penser à une certaine esthétique moderniste néo-mallarméenne. La filiation avec Mallarmé est-elle avérée ?
Cassiopée Peca est composé de 10 feuillets en format A2, pliés et reliés par Nobuyoshi Kikuchi pour former un livre, accompagné de son coffret. C’est donc une sorte de livre-objet, en tous les cas un livre qui ne ressemble pas à un livre. Je ne dirais pas qu’il s’agit d’une poésie mallarméenne. En même temps, je dois reconnaître que je n’ai rien inventé, ni forme ni contenu. Alors quand je dis non, ça doit vouloir dire oui… Du moins, la filiation n’est pas directe même si, en travaillant sur cette forme de vers, je ne peux pas ne pas reconnaître un certain héritage de Mallarmé en particulier et de la modernité poétique en général. En vérité, ce sont plutôt les artistes conceptuels qui m’ont le plus inspiré. Je pense par exemple à On Kawara, aux membres de Fluxus, aux artistes de la performance.
C’est-à-dire à des artistes qui laissent quand même beaucoup de place au langage ou acte la transformation des mots en images.
Ce sont aussi des artistes qui ont réfléchi aux espaces d’exposition scénographiés et à la relation entre l’œuvre et son environnement, c’est-à-dire des préoccupations que mon propre travail traduisait dans l’espace de la page. Je concevais le poème non pas comme un texte fini mais comme une sorte de « rouleau » capable de se déplier dans toutes les directions et par lequel les mots se branchent et se déploient indépendamment les uns aux autres. C’est ce principe qui anime Cassiopée Peca puis (Com)position, en 1996, suivi de Diapositives luminescentes, en 2000. Ces deux livres rassemblés ont donné naissance à Calque, publié chez P.O.L, en 2001.
Une revue m’a aussi particulièrement influencée – la revue Kirin – qui réunissait un groupe de poètes d’inspiration formaliste qui deviendront de grands lecteurs de littérature française comme Ryōji Asabuki et Hisaki Matsuura, qui sont par ailleurs tous les deux professeurs de littérature française, poètes et romanciers. C’est par ce biais que j’ai pu intégrer en quelque sorte la poésie française moderne et contemporaine. Plus tard, il y a dix ans environ, j’ai rencontré Ryōji Asabuki.
Votre rythme de publication est soutenu et votre écriture est très fluide. Comment travaillez-vous ? Écrivez-vous au petit matin, la nuit, en séances intensives, précipitées ou apaisées ? Dans quelles conditions ?
Je ne fais que travailler. On me demande comment je fais mais c’est simple, je ne fais pas autre chose. Je n’ai absolument pas de vie familiale, je n’ai pas d’enfant, je n’ai pas de chat. Je vis une vie égocentrée. Ma vie entière tourne autour du travail. Je commence à travailler dès le réveil, aux alentours de 6h du matin puis j’investis plusieurs supports au cours de la journée. Si je ne faisais que de la traduction, je ne pourrais probablement pas tenir comme ça toute la journée – je ne suis pas si endurante – mais j’alterne les textes et les écritures : par exemple, je travaille trois heures sur une traduction, puis trois heures sur un article journalistique et puis encore quelques heures sur une traduction de Manga. Tous les jours, de 6h à 19h. Les journées passent vite.
Concernant mon écriture, je dois dire qu’elle a complétement changé quand je suis passée de la poésie à la prose. Chaque poème était une lutte, une écriture éprouvante. Je devais toujours créer un cadre ou une structure avant d’écrire et repartir de zéro à chaque poème. À partir de Ce n’est pas un hasard, en 2011, qui est un livre consacré à Fukushima et à la série noire de catastrophes qui ont traumatisé le Japon : séisme, tsunami, fuite radioactive… tout est devenu beaucoup plus simple grâce à la prose. Le terrain de la prose s’est avéré être un terrain accueillant. Évidemment, la langue est aussi devenue très neutre, très accueillante d’une certaine façon. Ce serait trop dire d’affirmer que je ne me soucie plus de la langue mais quand même ce n’est plus mon souci principal. Je sais que je ne pourrais pas être un écrivain virtuose en français, mais en un sens c’est très bien. Je connais mes limites et ça me facilite le travail. Je n’essaye pas de faire des choses que je ne sais pas faire, alors que quand j’écrivais de la poésie, c’était comme essayer de sauter à 3 mètres du sol.
Deux choses me frappent dans ce que vous dites. D’abord, je suis surpris de voir la facilité avec laquelle vous êtes passée de la poésie à la prose, comment une écriture si conceptuelle et contrainte a réussi à se muer en écriture sensible et pour ainsi dire chantante. C’est une métamorphose qui vous révèle dans la prose. Ensuite, je suis frappé par cette façon de raconter la fragilité même de votre « devenir écrivain », le sentiment de la précarité ou la conscience de la possibilité de ne pas être écrivain : si vous n’aviez pas eu ce grand-père, s’il n’y avait pas eu ce jury, si vous n’aviez pas quitté le Japon, si vous n’aviez pas été « accueillie par la prose »… Alors que beaucoup d’écrivains ont plutôt tendance à mettre en avant l’idée de la vocation et leur rêve de devenir « grand écrivain ».
Un jour, j’ai simplement été chassée de la poésie – je ne pouvais plus écrire – et si la prose ne m’avait pas accueillie, le couperet serait inévitablement tombé, j’aurais arrêté d’être écrivain. Si vous voulez une image, c’est comme naviguer dans un courant trop fort, au risque de la noyade quand tout d’un coup on aperçoit une autre rive qui est un territoire inconnu. J’ai mis du temps à comprendre que c’était là que j’allais vivre mais aujourd’hui c’est décidé, je sais que c’est dans la prose et dans l’essai que je vais finir ma vie d’écrivain.
Aussi, je ne crois pas qu’un écrivain est né écrivain et doit rester écrivain tout au long de sa vie. Vous savez, c’est un peu comme les sportifs : il est vraiment très rare de pouvoir mener carrière jusqu’au bout. Comme si on devait rester écrivain toute sa vie… Ce n’est pas vrai. La vie d’un écrivain n’est pas une vie ordinaire que l’on peut confondre avec la vie d’un corps organique. Il y a des accidents et il y a de la chance, et le plus important est que ce n’est pas nous qui décidons. Il faut être très conscient de la fragilité de la condition d’écrivain.
Derrière les écrivains que l’on connaît, qu’on lit et qui sont publiés, combien ne sont pas publiés ? Pour deux ou trois auteurs connus, combien d’écrivains inconnus ? Combien auraient pu devenir écrivain mais ne sont tout simplement pas nés sous la bonne étoile ? Combien ne peuvent-ils pas vivre de leur travail ? Combien de fois les aléas de la vie et du destin ont-ils frappé de plein fouet de jeunes écrivains prometteurs ou de grands auteurs confirmés ? Si on devient écrivain pour toutes sortes de raisons, il faut ajouter que l’on devient écrivain sous de multiples conditions. Car devenir écrivain n’est jamais une évidence. D’abord parce que la route est semée d’embuches ; ensuite parce que tout peut s’arrêter et se taire à tout moment. Un drame peut surgir et l’écriture se défaire. L’impossibilité de l’écriture n’est pas moins probable que la possibilité de l’écriture. C’est peut-être pour cela que j’écris beaucoup d’ailleurs, sans perdre de temps.
Pourtant vous donnez aussi le sentiment d’un parcours sans faute ou du moins d’une carrière menée tambour battant…
Je sais qu’on peut diviser le monde en deux camps – ceux qui ont connu la guerre et ceux qui n’ont pas connu la guerre. Mais on ne sait jamais quand une guerre peut éclater et quelles seront les lignes de front. Depuis tout petite, je suis consciente de la fragilité des vies et des choses. Je ne sais pas ce que demain nous réserve et c’est pour cela que je ne veux rien regretter. Alors je suis opiniâtre : j’écris tout ce que je peux, tant que je peux. J’ai aussi eu la chance de débuter ma carrière très tôt, cela signifie que j’ai connu d’autres générations d’écrivains : ces poètes qui avaient cinquante ou soixante ans quand j’en avais vingt sont tous morts ou presque, aujourd’hui. Le temps passe et la mort vient. C’est peu de dire que la vie d’un écrivain est fragile ; en vérité, la vie est courte et fragile.
Même si vous avez sacrifié une partie de votre vie à l’écriture ?
Je ne parlerais pas de sacrifice et je suis heureuse de ma vie d’écrivain. Même si j’avais été très riche, j’aurais continué à écrire et à me lever tôt. C’est vrai qu’il y a beaucoup de « fantômes » dans ma vie et que je me suis relativement retirée de la vie réelle, même si je profite quand même de la vie par ailleurs. Du moins, je bénéficie d’une bonne santé, tout comme ma famille et ça n’a pas de prix. La bonne santé est un paramètre simple que beaucoup de gens oublient de prendre en considération alors que c’est une chance inestimable sans laquelle le temps de l’écriture n’est pas possible.
Aujourd’hui, vous écrivez à la fois en français et en japonais. Pouvez-vous expliquer comment s’est concrétisé ou négocié votre rapport à la langue française ?
Ma première langue étrangère était l’anglais, que j’ai commencé à étudier à partir de 13 ans, au collège. Pour la deuxième langue étrangère, j’avais le choix entre le français, le chinois, le russe, l’allemand et l’italien, si je me souviens bien. J’ai tout de suite choisi le français parce que j’ai pensé que je mangerais bien.
À part cet intérêt pour la cuisine française, la langue française était-elle investie d’autres stéréotypes ?
J’écoutais beaucoup de musique baroque et de la Renaissance, puis j’ai pris des cours de chant à l’université donc mon intérêt pour la langue française – étonnamment – concernait d’abord les formes de l’ancien français. Avant d’étudier l’histoire de l’art en Maîtrise, j’ai étudié la langue d’oïl. Aussi, au lieu d’écrire un mémoire standard de Licence consacré à tel ou tel auteur, tel ou tel aspect d’un texte, j’ai voulu proposer une traduction d’un poète trouvère et chevalier champenois de petite noblesse du XIIe siècle, Gace Brulé. Je participais aussi à une chorale de musique baroque et j’apprenais un peu le clavecin, alors tout ceci faisait sens.
En tous les cas, grâce à ce projet de traduction des chansons de Gace Brulé, j’ai découvert et compris un autre concept de la poésie et de l’idée même de texte, plus proche de la performance, plus plastique aussi, capable de variations infimes et infinies. Avec ce type d’objet textuel, l’originalité s’efface. Il n’y a pas à proprement parler de texte original ni même un auteur au sens où on l’entend aujourd’hui. Cinq poèmes peuvent se ressembler avec un seul mot de différent et parfois ces mots qui diffèrent signifient tous la même chose. Comment traduire ces infimes variations de couleurs et de sens ? Si vous voulez, c’est comme les séries de gravures de Picasso au sens où c’est le détail qui fait la différence. Où est la version finie ? Elle n’existe pas. Quel est le texte qui fait autorité ? Tous et aucun à la fois. Autrement dit, c’est une autre idée de la poésie qui m’a été donnée de comprendre avec ce corpus, aussi une autre idée de ce que peut être un livre quand il est tissé de variations infinies et que jusqu’à la dernière page peut surgir un tout autre poème.
C’est aussi une belle définition de la traduction.
Exactement. Chaque fois, traduire revient à chercher un autre mot pour ne pas dire exactement la même chose tout en cherchant à dire la même chose. La traduction est la recherche d’une similitude qui échappe, une écriture qui ne s’arrête pas ; c’est comme passer de l’écriture au chant – c’est une modulation infinie.
Apprendre une langue est une épreuve d’endurance. Je pense à une auteure iranienne, Chahdortt Djavann qui raconte dans Comment peut-on être français ? les frustrations de ne pas réussir à dire exactement ce que l’on veut dire dans une langue étrangère, finalement le sentiment d’être une éternelle étrangère et la culpabilité de laisser derrière soi son pays d’origine. Avez-vous vécu ce genre de trajet compliqué ?
Non. D’abord parce que je ne suis pas exilée et que le Japon n’est pas l’Iran, même si je sais qu’il y a beaucoup de censure et d’autocensure au Japon, ce n’est pas comparable avec l’Iran. Par ailleurs, je n’ai jamais abandonné le japonais, même si j’écris de moins en moins en japonais, mais je n’ai jamais abandonné ma langue maternelle. Je publie aussi au Japon, en japonais. L’année dernière, j’ai publié La voix sombre, Ce n’est pas un hasard, Manger fantôme et l’éditeur a voulu appeler ce regroupement de textes « Trilogie de catastrophes ». D’une certaine façon, je suis encore présente au Japon. Aussi comme traductrice. Aussi, mon rapport avec ces langues – le japonais, le français – n’a jamais été quelque chose de figé. J’ai commencé à écrire en japonais puis j’ai appris le français et j’ai commencé à traduire en français ce que j’écrivais en japonais. J’ai autotraduit mon premier livre publié en français. Pour Cassiopée Peca, la traduction a été collective. Pour Héliotrope, le texte en japonais existait déjà. En revanche, pour les deux livres publiés au Bleu du Ciel, Adagio ma non troppo et Études vapeur, j’ai écrit simultanément en japonais et en français. Puis je suis passée à la prose. Ce n’est pas un hasard est le premier texte que j’ai écrit directement en français. Nagori n’est pas encore traduit en japonais. 961 heures à Beyrouth est en partie traduit en japonais mais a été écrit en français. Alors je ne sais pas si le trajet est compliqué ou fluide…
Traduisant « dans les deux sens » (du français au japonais et vice-versa), vous dites que vous êtes « traversée par une certaine manière d’être à deux ». Vous dites aussi que vous vous sentez chez vous dans les « terrains vagues ».
D’une certaine façon, je suis devenue deux auteures différentes et j’ai progressivement commencé à traduire ce que j’écrivais en français en japonais. J’écris en deux langues, simultanément. Aussi, s’expérimenter à la fois comme auteure et traductrice est une expérience assez étrange. C’est pour cela que je dis que la traduction est ma véritable colonne vertébrale.
Dans un entretien avec Arnaud Laporte, vous dites pourtant : « L’hiver, je pense souvent à la lumière de Tokyo, au bleu, au ciel dégagé. Je vis deux saisons en différé. » Le rythme n’est pas toujours simultané, la coïncidence des temps n’est pas toujours au rendez-vous.
Je ne pourrais jamais être l’écrivain d’une seule langue. Je ne pourrais pas être seule, si je puis dire, ni profiter d’une seule identité ni d’un seul temps. Ce que je veux dire, c’est qu’écrire implique aussi une expérience du temps, selon différents aspects et modalités. Pourtant, à chaque nouveau texte, c’est la même précarité qui est en jeu. Le bleu du ciel de Tokyo est incomparable. Il ne pourrait pas être vécu à Paris. La traduction ne permet pas de passer d’un pays à l’autre ou d’une langue à l’autre ni même de faire se correspondre des identités mais bien plutôt de mesurer toute une série de différences et de délais. Aussi, l’auteure que j’étais à 30 ans n’est pas celle que je suis aujourd’hui. L’identité d’un écrivain est très fluide. Comme disait l’artiste conceptuel On Kawara, chaque jour je suis une nouvelle personne. De la même façon, j’écris dans plus d’une langue, chaque jour nouvelle.
En un sens, écrire en deux langues revient à coordonner un travail de traduction généralisé. Par exemple, le projet de 961 heures à Beyrouth était de traduire une grammaire de la cuisine libanaise en français. Charif Majdalani voulait un livre pour raconter la rencontre de l’Europe, de l’Asie et du monde arabe. En écrivant un livre sur Beyrouth, j’ai écrit un livre sur les souvenirs des gestes de cuisine en 40 jours donc en 961 heures. 961 est aussi le code téléphonique pour appeler le pays. L’histoire des plats et des façons de préparer la cuisine est une histoire des transferts culturels : je suis une traductrice des goûts et des cuisines.
Vous n’avez pas envie de traduire d’autres langues ?
C’est vrai que j’avais envie d’apprendre toutes les langues mais je me suis finalement attachée au français et au japonais. J’ai étudié le latin, l’anglais, l’italien, le persan mais je sais aussi que je n’ai pas assez de temps. Pourtant c’est ce qui m’arrive assez souvent, par hasard. J’ai traduit Atiq Rahimi. J’ai aussi traduit le premier livre de Daniel Heller-Roazen qui est Professeur à l’Université de Princeton et traducteur de Giorgo Agamben, Echolalies. Essai sur l’oubli des langues, au Seuil, dans la collection « La Librairie du XXIe siècle », qui est un livre magnifique. J’ai aussi traduit en japonais Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau qui est écrit en français bien-sûr mais avec des incrustations de créole, parfois avec un créole inventé de toute pièce, c’est-à-dire écrit dans une langue qui d’une certaine façon n’existe nulle part. Finalement, je ne traduis vraiment qu’à partir du français mais souvent avec une autre langue qui l’accompagne et qui complique quelque peu la tâche. Par exemple, je viens de traduire un livre estonien en japonais à partir du français parce que l’éditeur n’avait pas trouvé de traducteur littéraire en estonien. Il s’agit de L’Homme qui savait la langue des serpents d’Andrus Kivirähk.
Les rapports entre la traduction du japonais vers le français et du français vers le japonais semblent assez inégaux. Si peu d’auteurs français contemporains sont aujourd’hui traduits en japonais – Modiano, Le Clézio et Houellebecq sont connus – la littérature japonaise connaît une belle réception en France. Murakami est traduit dès 1990, Tanizaki entre dans la Pléiade en 1997, d’autres écrivains japonais comme Yōko Ogawa connaissent même le succès en France avant de le connaître au Japon, sans compter l’engouement pour les mangas. À quoi tient, selon vous, la passion française pour le Japon ?
Je crois que cela a été préparé de longue date mais aujourd’hui une nouvelle génération de jeunes gens et de jeunes femmes très talentueux a pris le relais et connait très bien la langue japonaise. Ces nouveaux traducteurs ont souvent vécu au Japon, connaissent la culture, l’esthétique, la vie quotidienne, les attitudes et la mentalité japonaises. Ce sont de grands connaisseurs du Japon et des traducteurs très compétents. Je pense par exemple à Deborah Pierret-Watanabe qui me semble ouvrir de nouveaux horizons à la traduction.
Vous vivez en France depuis maintenant 20 ans. Depuis votre expérience, quelles sont les évolutions manifestes des échanges franco-japonais ?
D’une certaine façon, le Japon est devenu très proche de la France. Je ne sens plus vraiment de distance culturelle. Bien-sûr, il y a vingt ans, la France connaissait déjà les dessins-animés japonais et les mangas mais si on prend l’exemple de la cuisine japonaise, il faut reconnaître qu’elle était encore rare dans les années 2000, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ce qui montre bien à quel point le Japon est présent culturellement en France. Même la langue japonaise n’est plus une langue mystérieuse et lointaine.
Qu’en est-il de la présence de la France au Japon ?
Dans les années 60 et 70, la France profitait d’un certain prestige avec son cinéma, sa littérature, sa philosophie, ses sciences humaines ; ce n’est plus le cas aujourd’hui. Au Japon, plus personne ne fantasme la France. La faute en partie à la négligence des éditeurs et des traducteurs qui ne publient plus ou très peu d’écrivains ou de penseurs français. La littérature anglo-saxonne contemporaine est devenue hégémonique. La France a perdu son aura, non seulement au Japon mais aussi partout ailleurs dans le monde. Je pense même que les japonais ont une image négative de la France : les attentats, les gilets jaunes. Quand on vit en France, on sait que ce n’est pas la réalité et que le pays ne se résume pas à ces phénomènes sociaux mais quand on est loin, malheureusement on ne voit plus que ça.
Y-a-t-il des auteurs français que vous voudriez faire connaître au Japon ?
Quand on est traductrice, on distingue les auteurs qu’on aime des auteurs qu’on traduit. Les deux catégories ne se recoupent pas nécessairement. Parfois, c’est le cas ; parfois, non. Et dans d’autres cas, je dois reconnaître que je ne suis pas nécessairement la meilleure pour traduire tel ou tel texte : il faut connaître ses forces et reconnaître ses limites. C’est pour cela que j’aime beaucoup diriger cette collection chez Picquier, parce que je peux déléguer les traductions. Surtout, je sais aussi qu’être traducteur, c’est parfois faire le choix de ne pas traduire.
photo Ryōko Sekiguchi © Alexis Nice pour la maison Perrier-Jouët et JBE Books
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 23 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
"France3-régions"
06/03/2026 - 15:51
Breiz-info.com
26/02/2026 - 22:43
Laura Spinney ("Observer.co.uk")
24/02/2026 - 08:04
Commentaires récents
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
PARCE QUE TU T'IMAGINES...
Albè
09/03/2026 - 19:30
...une seule seconde que j'ai tenté d'alphabétiser bun crétin de ton espèce ????! Lire la suite
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
Négro blanc raciste humanitaire vivant sous tropiques froids .
yug
09/03/2026 - 18:32
Je te rassure sur mon identité :
Lire la suiteDerrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
PARASITE 1er
Albè
09/03/2026 - 18:11
...autrement dénommé "YUG" (l'un de ses multiples pseudos lui servant à éructer ses âneries dans Lire la suite
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
Yug-hitler= intello?
@Lidé
09/03/2026 - 17:16
le temps long est le la matière des anthropologues (ce n'est pa son gros mot, hein!!!!!?)
Lire la suiteDerrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
Yug-hitler= intello?
@Lidé
09/03/2026 - 17:09
le concept temps n'est pas d'albè mais de fernand Braudel historien français, de plus
Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- T'es géniale, Naïka, mais fais attention aux racailles et autres rappeurs opportunistes !
- Tout goudron, tout béton et l’on s’en fout du rhum Neisson
- Non, les Martiniquais ne sont pas du tout assimilés aux Gaulois !
- Agression Israélo-yankee contre l'Iran : ne pas se laisser manipuler par les médias !
- « Sale bougnoule » : à Marseille, la candidate de gauche Hanifa Taguelmint insultée par des militants RN en plein tractage
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus