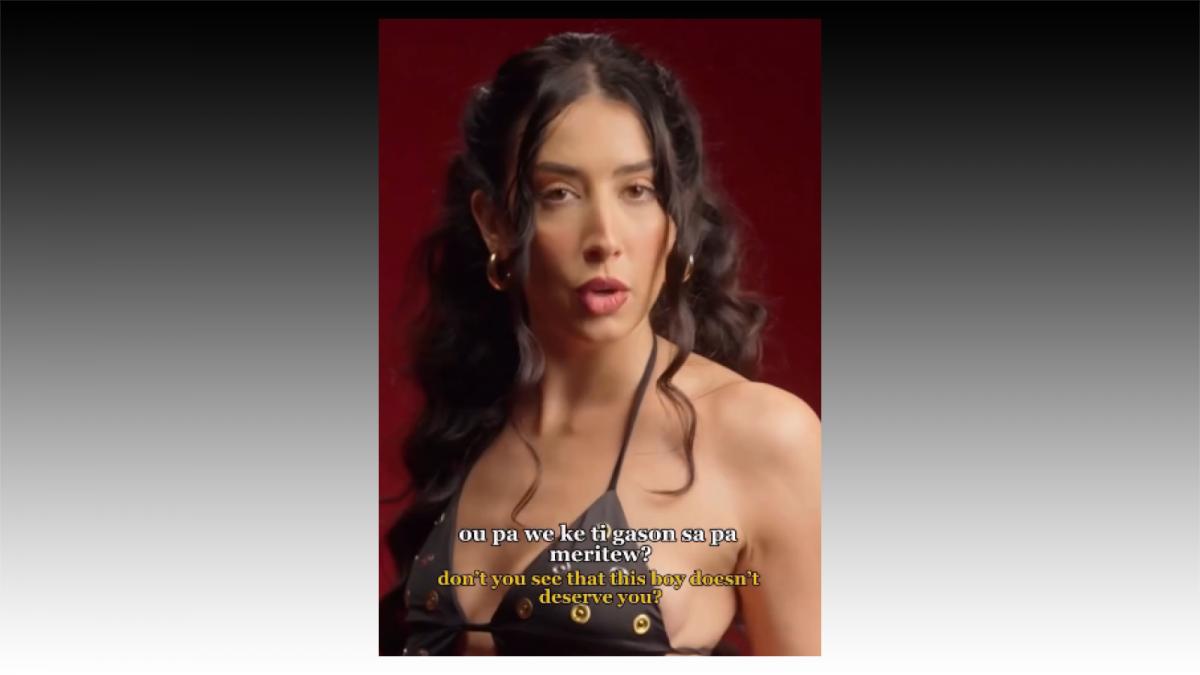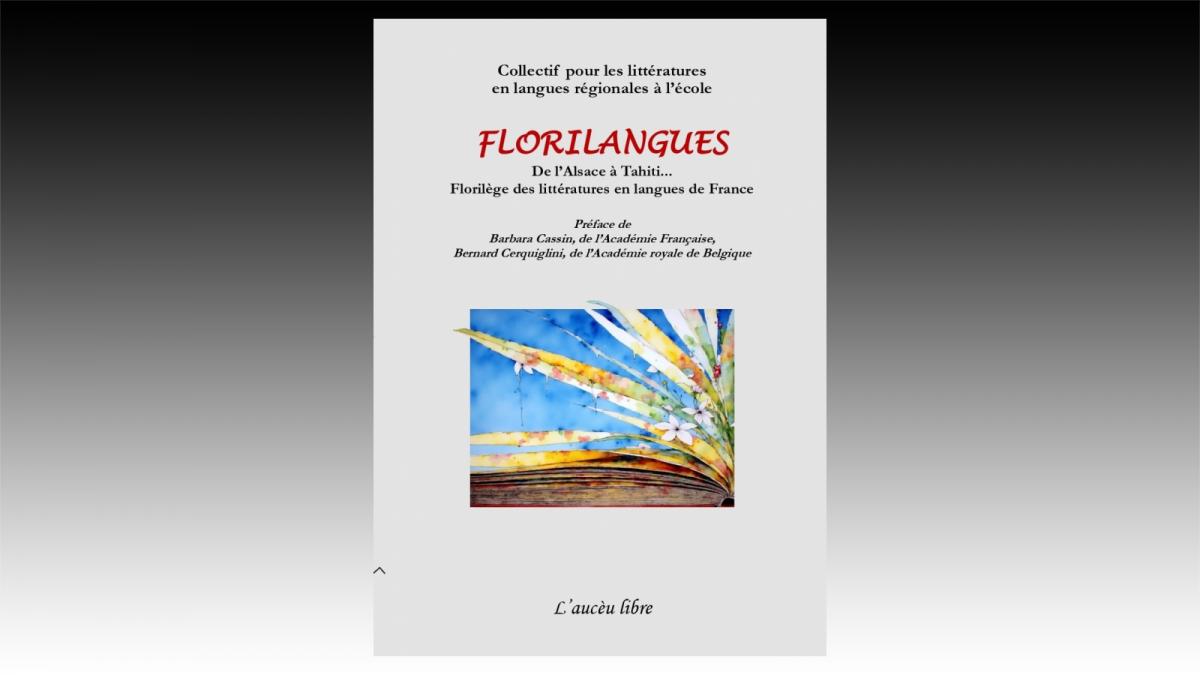La hauteur du combat

C’était le temps du zouk et des midi-minuit. En ce temps-là, je dansais avec des corps rapprochés que je ressentais contre le mien, avec ce souffle chaud qui vous parcourt la nuque, ces effluves de luxe ou de morue salée qui parfois manquent de vous faire tomber, ces formes que vos mains perçoivent à travers des vagues de coton ou de soie. Je restais souvent planté un bon moment, comme un arbre poussant des branches supplémentaires, attendant que des fleurs vrillent ou qu’elles se transforment en bourgeons aériens, observant avec des yeux de souterrain, et qui sentent ce parfum des choses de la nuit.
Je restais les pieds sur terre un long temps, pendant que les corps s’entrechoquaient entre des notes de cuivres, de cordes pincées électriquement et qui montent piano piano, de clair coups de caisse qui vous désarticulent ou déploient vos sons graves en plein milieu du monde. Je sentais tous ces chocs dans ma pousse d’arbre-observateur, et les gouttes d’eau-de-vie que l’excitation et les rires déposaient sur ma peau, et puis au bout de la mise en relation, je tentais ma chance. J’esquissais ma danse. Je chauffais mon corps contre un corps, un autre corps, encore un autre corps, tenir gagner chaque corps. En ce temps-là, c’est vrai, il faisait la même température à midi ou à minuit, déjà.
Si ce qu’on dit est réel, si la température centrale d’un corps se stabilise autour de 37°C, si ce corps passe son temps à échanger de l’énergie avec le milieu extérieur, s’il est capable, au repos, de libérer une puissance thermique d’environ 100 watt, alors je vous laisse imaginer ce que deux, trois, quatre, cinq, six ou sept centaines de corps agités échangent de sueur, de vapeur de bouche et de tafia, de joie de rire, de passion du mouvement et de cris de rêves, et ce qu’ils sont, ensemble, capables de brûler comme de petits astres solaires libérant l’énergie des étoiles accumulées.
En ce temps-là, une fois le soir incendié, les arbres et les feuilles tombées, les bruits consumés, on parlait de se rencontrer vraiment. D’accoler des peaux l’une sur l’autre, les unes sur les autres, de laisser filer la métaphore de vie, et puis voir ce que demain aurait porté pour nous.
Les lendemains, on entrerait dans un restaurant en saluant qui voudrait bien nous accueillir, on s’assiérait dans un bar ou resterait debout si ça nous chante, on se poserait librement sur une savane ou ailleurs, avant d’échanger des paroles qui démasquent à mesure qu’elles se rapprochent l’une de l’autre, nous rapprochant les uns des autres. On en savait si peu sur ce qui est à découvrir de la rencontre qu’on était si heureux de pouvoir la faire. En ce temps-là, ce qui importait pour battre le faire était l’espace disponible dans le lieu. Les portables servaient à se parler à distance. Les appareils des serveurs servaient à passer commande. Le plus souvent, c’étaient des appareils en papier ou ceux qui travaillent l’hippocampe.
Il n’y avait plus de lieux interdits aux Nègres, aux Esclaves, aux Femmes, aux Juifs, aux Barbares, aux Sans-Papiers et j’en passe. Seuls les chiens, enfin la plupart des animaux étaient proscrits et se taisaient. Plus de panneaux de ségrégation, plus d’affiche anti quelque chose, plus de carte d’indigent, de livret, de passeport ou de dompas. La question cruciale était surtout : que faire ? ou encore : que manger ? voire : que dire ? En vérité, je vous le dis, l’autre question cruciale était surtout : combien ça coûte ? La hauteur du combat.
C’est le combat que tu peux prendre à hauteur ou profondeur de ce que tu peux gagner. Pas dans l’étendue. Non. Là, ici et maintenant. Que pourrais-tu gagner qui te rendrait la vie plus belle ou l’existence plus juste ? C’est un départ de bon sentiment qui peut vous mener loin, très loin derrière des fagots où, là encore, des arbres, des branches et des feuilles dictent la tombée du jour ou de la nuit en plein corps. Ce que tu peux gagner, tu le gagnes à la sueur de ton front, à la force de tes muscles, à l’éclat de tes neurones, et ce que tu peux laisser juger, c’est le résultat de tout cela, avec la manière dans le geste de réalité.
En ce temps-là, pour travailler, tu n’avais d’ailleurs pas besoin d’autre chose. Tu pouvais compter sur toi, ta force, ton intelligence, tes compétences, ton réseau et la structure du marché de l’emploi. CV ne rimait pas avec santé. Travailler oui ! En tout cas dans toutes les fables du capital. Tu pouvais donc prendre ton combat ou même entrer dans un combat sans bâton, avec l’objectif fixé par ton espoir. Les salaires bougeaient encore ; parfois. Plus rarement que souvent, ils dégelaient dans la chaleur et l’envolée des prix. L’eau coulait comme elle pouvait sur des corps tiquetés comme des peaux de banane. Il y avait du gaz dans l’air, mais aussi de l’or noir dans le noir métal de ta colère en crues.
La colère, tiens… Elle était de ces pêchés qu’église et capital avaient conçu comme nomenclature de notre rose des vents. Gravir un col. Changer d’ère. Mettre les pieds dans une zone d’incandescence qui fait fondre l’obéissance aux dits commandements. Non, l’église du capital n’aime pas ça ! Elle qui vit dans le secret des dieux, le cul sur un saint siège, à l’abri des regards, avec de grandes mains baladeuses et de grands freins dépliés, découvrant jour après jour, point par point, toutes les nudités qui soient, de celle du plus petit à celle du plus grand de ses enfants.
La colère tiens, tiens… Matrice que les hommes qui ne créent comme les femmes essaient toujours de tenir en laisse, afin d’abriter les pouvoirs qu’ils se sont conférés. Oui, mais la colère, c’est comme le chocolat-communion, ça chauffe, ça bout, ça fait de la crème et des grumeaux, puis ça déborde les fait-tout quand on oublie le feu. C’est comme ça dans toutes les cuisines où les cuistots se prennent tous pour des cordons-bleus et des top chefs, derrière leur plaque vitrocéramique et leur vitreuse expérience du monde. Quand on n’écoute plus les petits sons d’ébullition et les gros mots du mépris, les déserts sont des créations du silence ; quand on regarde de haut ceux qui habitent en bas, ceux que l’on n’entend pas, à quoi bon jouer l’étonné philosophe quand la machine s’emballe, que la vie drive en violence aiguisée entre les fates molettes du broiement des impuissants ?
Il est vrai, ces temps-ci, la violence est un péché capital, en particulier quand elle est illégitime et qu’elle émane d’autre part que du Monopole de la violence et de ses forces de l’ordre. Plus encore quand elle s’abat sans distinction. Elle n’accouche plus de rien, surtout en partant dans un sens autre que vertical. Elle est synonyme de mort, de mal, de folie, d’irrationnel et n’a plus de sens politique. D’ailleurs, on dirait presque qu’il n’y a plus de sens politique du tout. Sinon, les gens ne descendraient plus autant des partis et des syndicats pour monter dans la rue pour tout et rien, pour s’assembler en nuit, en place, en rond-point, en lakou, en jaden, ou en cimetière d’esclaves dès que l’occasion se présente, n’est-ce-pas ? Ils n’occuperaient pas à tout bout de champ l’espace réservé aux porteurs de parole assermentés ; à la moindre petite déception ou au moindre petit dérangement personnel avec le système ; cet espace public. Si le politique avait un sens, est-ce-que les gens iraient défier la loi et l’ordre dans des amas composites d’aigreurs, de frustrations, de déceptions, de rancœurs et de ressentiments, voire de dégoûts ?
Moi-même, je ne sais pas. Ce que je comprends me laisse un goût de mer profonde sur la langue. La loi et la justice étaient pourtant censées nous protéger des errances. Des gens formés, expérimentés, des gens élus entre tous, étaient censés devenir les gardiens de la cité, ceux qui éradiquent la violence à force de sagesse et de raison élevées. Je ne comprends plus rien à ce qu’ils disent. On n’a pas les espoirs qu’on mérite, surtout pas quand il se hissent sur des mensonges involucrés. Alors je dépose les espoirs miens dans la main du souverain. Dans le tao du lieu-commun. Celui qui démocratiquement aura à dire et fera. Qu’il soit seul ou qu’il s’assemble en masse. Celui qui volera la parole aux dépositaires de la conscience collective et autres techniciens du chaos.
Je dépose ça là, en silence, pour la hauteur du combat avenir.
LORAN KRISTIAN, le 21/11/2021
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 576 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Par Pablo Patarin
10/03/2026 - 21:25
"France3-régions"
06/03/2026 - 15:51
Breiz-info.com
26/02/2026 - 22:43
Laura Spinney ("Observer.co.uk")
24/02/2026 - 08:04
Commentaires récents
Carnaval : le Danmyé de la discorde
PFF !
Albè
11/03/2026 - 17:53
Me manipuler, moi ? N'importe quoi ! Lire la suite
Carnaval : le Danmyé de la discorde
Albè, monthieux vous manipule
@Lidé
11/03/2026 - 16:28
cet article sur les réseaux d'extrème droite. Lire la suite
T'es géniale, Naïka, mais fais attention aux racailles et autres rappeurs opportunistes !
RAPPEURS "FOUANCAIS"
Albè
11/03/2026 - 11:23
Trop tard ! Lire la suite
Agression Israélo-yankee contre l'Iran : ne pas se laisser manipuler par les médias !
Yug, pour une fois...
Frédéric C.
10/03/2026 - 22:20
...je suis d’accord avec vous. Lire la suite
Agression Israélo-yankee contre l'Iran : ne pas se laisser manipuler par les médias !
Certains politiques ou consultants TV sont pires ...
yug
10/03/2026 - 20:31
Vous avez bcp entendu évoquer le merveilleux "Droit international" depuis 10 jours, pourtant b Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Ce roman français rocambolesque d’une autrice réunionnaise vient d’être élu parmi les meilleurs livres 2025 du New York Times (c’est une première historique !)
- La chanteuse franco-haïtienne Naïka : l'art de ne choisir aucune case
- Janet Jackson et le contrat prénuptial à 200 millions de dollars
- GAZA, IRAN : LUTTER CONTRE LA LOI DU PLUS FORT
- C’est une première en France : le Parquet européen ouvre une enquête sur la base d’un rapport de la Chambre régionale des comptes de La Réunion
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus