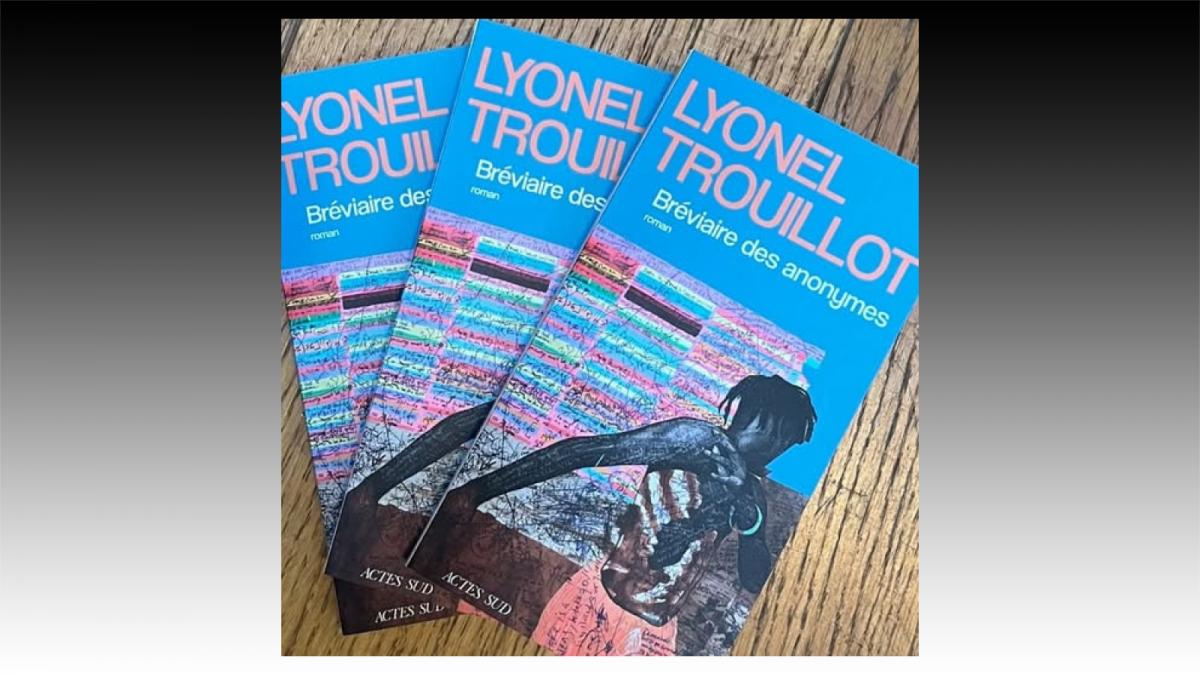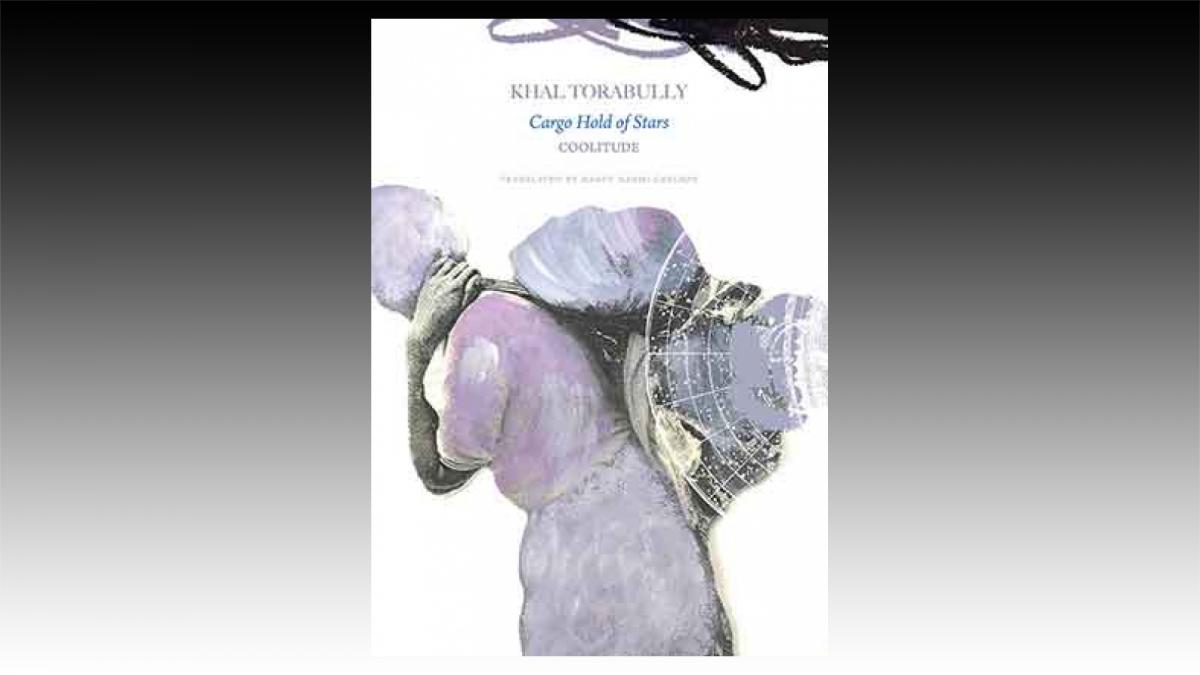Yanick Lahens : Des femmes face au chaos du monde
Propos recueillis par Georgia Makhlouf,

Yanick Lahens est une grande dame de la littérature haïtienne. Récompensée par de nombreux prix littéraires, dont le Femina en 2014 pour Bain de lune et le prix Carbet en 2020, à l’occasion du 30e anniversaire de sa fondation par Édouard Glissant, ses œuvres sont traduites dans le monde entier. Elle est également officier des Arts et des Lettres de la France.
En mars 2019, elle a été invitée par le Collège de France à tenir la chaire des Mondes francophones. Elle intitule sa leçon inaugurale : « Urgence(s) d’écrire, rêve(s) d’habiter » et développe, au fil de ses conférences, des réflexions passionnantes autour de l’exil, de l’oscillation permanente entre besoin d’ancrage et désir d’ailleurs, et de l’opposition entre littérature du dedans et littérature du dehors au sein de la création littéraire haïtienne.
Elle vit en Haïti aujourd’hui encore, alors que Port-au-Prince a basculé dans une violence extrême et subit la loi des gangs. Pourtant, son dernier roman, Passagères de nuit, qui vient de paraître, se tient à distance de cette actualité brûlante et nous emmène dans la Nouvelle-Orléans du XIXe siècle, à la rencontre des femmes de sa propre lignée. Construit sous la forme d’un double portrait de deux vaillantes héroïnes, Elizabeth et Régina, le roman déroule successivement deux récits qui semblent ne pas avoir de territoire commun, mais dont les liens s’éclairent au fil de la narration. Dans une langue superbe, ciselée, précise et subtilement poétique, Yanick Lahens rend un vibrant hommage à ces passagères de la nuit, ces oubliées de la grande Histoire qui tracent leur sillon avec constance et courage. « Ne disparais pas de ton vivant, la mort est là pour s’en charger. Promets-le-moi. » Tel est le conseil transmis à Elizabeth par sa grand-mère, et dans lequel elle va puiser le secret de sa résistance silencieuse face aux défis et aux violences du monde. « À toutes ces peines, j’opposais une souffrance à bas bruit. Non, l’espoir n’était pas une réponse. Je n’espérais rien », dit Régina qui trouve dans l’absence d’espoir « une force inimaginable ». Les deux femmes mèneront leur trajectoire d’émancipation avec une admirable vaillance.
Nous avons échangé avec Yanick Lahens par visioconférence et avons abordé avec elle quelques-unes des questions brûlantes que soulève son magnifique roman.
Je voudrais évoquer avec vous votre attachement à Haïti, qui vous fait continuer à vivre à Port-au-Prince alors que la situation y est particulièrement dangereuse, avec la violence des gangs qui s’étend partout. Est-ce par solidarité, par engagement, par nécessité, parce que là est la source de votre écriture ?
Il y a tout un ensemble de gestes, d’habitudes et de liens qui ont fait de moi qui je suis, et qui me rattachent à ce pays. Je dirais aussi qu’Haïti est un pays qui occupe une place centrale sur la carte du monde et qu’ayant conscience de cette place, je souhaite y rester. J’aime ce pays, j’estime que j’ai de la chance d’appartenir à cette culture qui est tout à la fois amérindienne, africaine et française. Toute l’Amérique, du Nord au Sud, y est présente, en même temps que l’Afrique et l’Europe. Avec cette si vaste ouverture, on a vraiment une longueur d’avance, on est bien outillé pour comprendre le monde. Et pendant que Port-au-Prince est livrée à l’insécurité et à la violence des gangs, il y a encore des activités culturelles et éducatives qui se maintiennent et il se passe des choses extraordinaires dans plusieurs autres régions du pays : des expériences agricoles intéressantes, des formations à la musique classique pour les jeunes, des actions solidaires formidables…
Dans la série de conférences que vous avez données au Collège de France en 2019, vous posiez la question : que peut signifier habiter un pays pour un écrivain, alors que son territoire est l’écriture ?
C’est en effet à travers la littérature que je réponds à cette question, que je dis ma manière d’habiter ce pays et le monde. La littérature est donc mon territoire intime. Dans chacun de mes livres se trouve une forme de réponse à cette question. Je dis comment je ressens les choses, je dis aussi mes colères, car ce n’est pas quelque chose de simple ni de tranquille. J’appartiens à la catégorie des écrivains qui, comme la majorité des hommes et des femmes, habitent quelque part en dépit des migrations des Suds vers le Nord. Il n’existe pas un universel dominant. Le voyage n’est pas une condition pour atteindre l’universel. Nous portons chacun et chacune une part d’universel et la littérature de surcroît, permet de transcender le temps et l’espace.
Vous évoquiez aussi les trois exils de l’écrivain : exil de l’écrit dans un pays dominé par l’oralité, exil de la langue française alors que le créole est la langue parlée par la majorité de la population, exil culturel et social consécutif au fait d’appartenir à un milieu social donné. Comment vous situez-vous aujourd’hui par rapport à ces exils ?
Bien que ces exils soient moins marqués aujourd’hui, le défi demeure que ces deux Haïti puissent se rencontrer et construire ensemble du commun. Dès le départ, les élites qui ont pris le pouvoir en Haïti ont voulu reproduire le modèle de la France. Mais la majorité, fraîchement arrivée d’Afrique, s’inscrivait dans une autre dynamique. Et elle a fini par se réfugier dans ce qu’on a appelé « le pays en dehors ». On ne peut pas vouloir refaire une colonisation de l’intérieur. Il faut vraiment repenser autrement notre socle commun.
Parlons à présent de ce dernier roman ; j’aimerais beaucoup vous entendre sur sa genèse. Mon sentiment est que vous portez ce texte depuis très longtemps. Est-ce exact ? Et a-t-il une dimension autobiographique ? Parlez-vous de vos lointaines grand-mères ?
Oui, en effet, je porte ce texte depuis longtemps. J’ai peu côtoyé mon arrière-grand-mère, elle est décédée alors que j’avais dix ans à peine et je n’ai pas eu le temps de la connaître vraiment ; mais j’avais quand même senti que c’était un personnage puissant, même si elle ne parlait pas beaucoup. Il y avait une photo où l’on voyait son compagnon, un homme à peau très claire avec son costume de général et sa belle moustache, alors qu’elle-même était très noire de peau. À l’occasion d’un séjour de vacances chez une tante en Floride, elle me livre quelques bribes sur cette ancêtre, Elizabeth. Elle serait venue en Haïti depuis la Nouvelle-Orléans avec sa sœur Sarah-Jane. Je prends quelques notes sur une feuille de papier que je garde pendant des années. Beaucoup de choses sont mystérieuses pour moi dans l’histoire de cette femme : pourquoi ce départ de la Nouvelle-Orléans, quelles sont les conditions du voyage pour deux femmes seules, comment se passe leur arrivée en Haïti, comment se fait-il qu’elle épouse un métis venu d’ailleurs lui aussi ?... Ce livre est parti de plusieurs silences qui ont creusé en moi l’envie d’en savoir plus.
Vous vous êtes donc engagée dans un travail d’enquête…
Je me suis avant tout intéressée à La Nouvelle-Orléans qui est un point focal de cette histoire. Ce que raconte l’histoire officielle sur la Nouvelle-Orléans du début du XIXe siècle est très différent de la réalité de ce qu’était ce territoire. Là aussi, il y a une chappe de silence qu’il faut soulever. Beaucoup de gens arrivent là en provenance de différentes régions du monde, il y a ceux qui fuient la révolution de Saint Domingue, il y a des Canadiens qui viennent d’Acadie, il y a des Français, il y a des pirates, des clandestins, des affranchis, et tout ce monde se mêle aux Indiens qui sont déjà là, ce qui représente un mélange assez exceptionnel de cultures et de peuples. La cuisine qui s’invente est créole, le jazz qui naît là est créole lui aussi, le vaudou est pratiqué par toutes les classes sociales et toutes les couleurs de peau, la langue est créole ; la Nouvelle-Orléans est donc le creuset d’une culture créole qui se crée de façon non institutionnalisée. Et ce qui m’intéresse beaucoup aussi, c’est que je découvre que les femmes noires ont une réelle puissance économique : elles font tourner les affaires. À l’époque, on estime que 75 % du commerce est non-officiel. Tout cela, cette dynamique incroyable, va changer quand Napoléon vendra la Louisiane aux États-Unis. Des lois restrictives vont être adoptées, on va interdire la pratique du créole dans les écoles… Aujourd’hui, il y a un retour à cette culture-là, une nostalgie de cette époque-là.
Dans votre roman, vous donnez aussi une place de premier plan aux femmes, à des femmes fortes quand bien même elles sont en situation d’indigence ou d’esclavage.
Oui, parce que dans la grande Histoire, les femmes sont absentes ; il y a tant de silence autour du rôle des femmes et de ce qu’elles ont accompli. J’ai voulu combler ce silence. J’ai voulu aller sur le territoire de l’intime.
Vous avez mis en exergue deux citations qui vont dans des directions opposées, celle de Justin Girod-Chantrans qui abonde en stéréotypes sur les femmes et en particulier les femmes noires, et celle de Jean Casimir qui cherche à déconstruire les récits dominants.
J’ai voulu montrer ce que l’imaginaire colonial véhicule, et dont on n’est pas encore complètement sorti aujourd’hui, surtout pour ce qui a trait à la sexualité et aux femmes de couleur. Cet imaginaire construit l’esclave comme un bien meuble et envisage les femmes comme une possession dont on peut disposer à sa guise. Le viol s’inscrit dans cet imaginaire. Le métissage que j’évoquais, il se fait dans ces conditions-là. Seul le roman permet d’explorer cette complexité humaine.
Quelle est la part de vérité, de faits avérés dans le double récit concernant ces deux femmes dont la vie s’inspire de celle de vos deux arrière-grands-mères ?
Je me suis beaucoup documentée avant de m’engager dans l’écriture, mais mon texte s’est affranchi de l’Histoire. D’une part, j’ai situé mon roman au XIXe siècle parce que je me suis aperçue que très peu de choses avaient été écrites sur cette période-là. Ce décalage dans le temps a permis que mon imaginaire se déploie et que je prenne des libertés avec l’histoire familiale puisque beaucoup de zones d’ombre subsistaient. Ce n’est donc pas non plus une biographie.
Le premier geste de liberté d’Elizabeth, son premier pas vers la prise en main de son destin, c’est un meurtre, ou plutôt une tentative de meurtre qui échoue. Elle a recours à une violence qu’habituellement les femmes subissent mais n’engagent pas.
Le corps des femmes est depuis toujours un territoire de guerre, et cela reste vrai aujourd’hui. Ces rapports de domination, ces tentatives de viol, sont permanents dans l’histoire des femmes. Elizabeth en a subi deux, et elle ne peut que recourir à la violence pour briser le terrible enchaînement des agressions.
Vous écrivez que les souvenirs servent à nous faire tenir debout. Cela va à l’encontre de la vision du souvenir comme simple manifestation de la nostalgie, voire du regret de ce qui n’est plus.
En effet, dans le roman, les souvenirs des victoires, même menues, de ces femmes leur permettent de faire face à l’adversité et de tenir le cap. Mais cela est vrai de moi aussi. J’étais dans une situation très difficile durant l’écriture de mon roman et je me disais, ces femmes ont tenu bon, et moi aussi je vais tenir. Elles m’habitaient tellement, je leur parlais, je leur disais « ne me lâchez pas ».
Vous parlez d’ « oser la joie », de la joie comme acte de résistance.
Il y a une paysanne qui vient toutes les semaines me vendre des légumes. Nous faisons un brin de conversation. Les aspects difficiles de sa vie, elle n’en parle que très peu. Mais j’ai trouvé chez elle de la joie, une joie spontanée qui n’a besoin de rien, qui n’est pas suscitée par l’acquisition d’un bien matériel ou par des succès de quelque nature que ce soit. Dans ce cas, la joie est subversive. Et c’est ce qui se passe avec mes héroïnes, elles résistent à ce qu’on leur impose ; on a voulu tuer la joie en elles mais elles résistent. Leur joie n’a besoin d’aucune justification, elle est juste là, entretenue comme une arme suprême.
Finalement, qui sont ces passagères de nuit qui ont donné au roman son titre ? Est-ce que vous avez voulu parler des esclaves qui voyageaient dans l’obscurité des cales de bateaux ?
La grande Histoire s’écrit par ceux et celles qui voyagent en pleine lumière. J’ai voulu porter l’attention sur celles qui voyagent de nuit, les femmes racisées et de condition modeste, mais qui font quand même l’Histoire. Michèle Perrot en parle très bien. Elle parle du silence de ces femmes et de ce qui se joue dans l’intime. Ce qu’elle écrit à ce propos fait vraiment écho pour moi. Ce sont elles les passagères qui ne peuvent voyager que de nuit.
Passagères de nuit de Yanick Lahens, Sabine Wespiesser, 2025, 230 p.
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 484 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
13/01/2026 - 11:39
Commentaires récents
Combat Ouvrier 1364 : "Les raisons de voter pour les candidats de Combat Ouvrier"
PROPAGANDE REVOLUTIONNAIRE, DIRAIT...
Albè
09/02/2026 - 08:31
...certains "commentateurs" qui sévissent dans la rubrique de ce site-web. Lire la suite
D'où l'expression "saoul comme un Polonais"...
TISSU DE CONNERIES POUR...
Albè
09/02/2026 - 06:48
...tenter de disculper l'élite corrompue occidentale et rejeter ses turpitudes sur les Russes. Lire la suite
D'où l'expression "saoul comme un Polonais"...
Epstein était très ,très probablement un espion russe.
yug
08/02/2026 - 18:25
1) Comment se fait-il qu'un simple "financier" connaisse , fréquente , tutoie , invite chez lui Lire la suite
Le pédo-criminel raciste de la Maison Blanche dans ses oeuvres
C’est quelque chose du même genre qui...
Frédéric C.
07/02/2026 - 18:50
...attend l’Ensemble Institutionnel Français (France + "Outremers") si le FN-RN et Reconquête acc Lire la suite
Saint-Esprit : le bilan de la mandature de Fred-Michel Tirault
J’avais compris, Albè...
Frédéric C.
07/02/2026 - 18:24
...mais je voulais en profiter pour clarifier certains points. Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Une première dans la Caraïbe ? La Dominique sur le point de devenir énergétiquement indépendante
- D'où l'expression "saoul comme un Polonais"...
- Le pédo-criminel raciste de la Maison Blanche dans ses oeuvres
- Ne pas vendre la peau du "lous-mamé" PPM avant...
- La ministre des Outremers dénonce le racisme...anti-blanc
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus