« Fanon » de J.-C. Barny, mélancolie postcoloniale ou mauvaise foi néocolonialiste ?
Nicola Lamri ("QG décolonial")

Le centenaire de la naissance de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, philosophe et révolutionnaire naturalisé algérien, a donné lieu à une véritable prolifération d’écrits, de rencontres et de produits culturels consacrés à sa mémoire.
Le cinéma n’est pas en reste. Deux films ont vu le jour entre 2024 et 2025 : le premier est une production algérienne au long titre « Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où Docteur Frantz Fanon était Chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956« , d’Abdenour Zahzah. Le second, une coproduction franco-luxembourgeoise-canadienne, s’intitule simplement « Fanon » et a été réalisé par Jean-Claude Barny. Passé sous silence en Europe, le travail de Zahzah se concentre sur la vie de Fanon lors de son séjour à Blida, lorsqu’il fut nommé chef de service de la clinique psychiatrique, révolutionnant ses méthodes profondément enracinées dans la technique psychiatrique raciste et coloniale de « l’Ecole d’Alger ». Le long métrage de Barny, quant à lui, se veut un véritable biopic, tentant de retracer la vie de Fanon, interrompue prématurément par une leucémie fulgurante, à l’âge de 36 ans, en décembre 1961. Pour l’instant, nous allons nous concentrer sur ce dernier. Mais nous reviendrons plus tard sur la relation problématique entre les deux films, qui ont été lancés presque en même temps et qui sont intimement liés tant sur le plan narratif que formel.
La réception de Fanon de Barny par la critique a été plutôt tiède. Il n’est pas question de se lancer dans une analyse esthétique du travail du cinéaste guadeloupéen. L’écriture mécanique, la musique de fond incessante, l’image plate et la structure narrative vacillante ont déjà été relevées par certains commentateurs. Cependant, les choix artistiques discutables et les erreurs techniques, qui étirent indéfiniment les 2 h 13 du film, finissent par occulter une série de choix politiques précis, que Barny décide d’imposer à la biographie du révolutionnaire algérien-martiniquais, entraînant ainsi des déformations significatives.
A la sortie de la salle, j’ai ressenti une forte frustration et un profond sentiment d’agacement, me demandant s’il aurait été opportun d’écrire quelques lignes en tant qu’admirateur de l’œuvre de Fanon, descendant d’indigènes algériens et chercheur en histoire. Finalement, j’ai décidé de surseoir : le film a été mal distribué en France, sévèrement critiqué par certains commentateurs, tout en suscitant un énorme enthousiasme, notamment auprès des jeunes générations racisées. La salle du cinéma UGC Les Halles, où j’ai assisté à la projection un dimanche soir de début avril, était complète. A la fin de la projection, le public a éclaté en applaudissements spontanés. Des centaines de jeunes, et même de très jeunes, dont la plupart identifiables comme des enfants de l’immigration africaine en France, se tenaient debout émous, en regardant le générique s’écouler à l’écran. Pourquoi s’en prendre à un produit qui a au moins permis de faire découvrir la figure de Frantz Fanon au grand public ?
Trois raisons principales m’ont incité à prendre la parole sur ce film. Tout d’abord, la déformation sciemment opérée par le réalisateur et son co-scénariste, Philippe Bernard, de la biographie de Fanon. Nous verrons qu’il ne s’agit pas de simples inexactitudes ou de la libre réinterprétation de la vie d’un personnage connu, mais de choix politiques précis visant à minimiser l’effet révolutionnaire et de rupture qu’il a porté, de l’intérieur, contre la société coloniale. En France, ce film a le mérite de raviver le débat autour de sa figure, mais quel effet peut-il avoir sur les jeunes racisés qui se précipitent au cinéma pour le voir ? Le Front de libération nationale algérien (FLN) y est décrit comme un mouvement déchiré par une violence fratricide, où les tendances les plus autoritaires et antidémocratiques l’emporteraient inexorablement. Quels conséquences un tel récit peut-il avoir sur nous, enfants ou petits-enfants d’immigrés des périphéries impériales, qui n’avons connu le colonialisme qu’à travers des récits distants ou par la transmission familiale ? Une mélancolie post-coloniale inversée semble ici se mettre en place. En son sein, la dégénérescence de nos sociétés, filles du traumatisme et de la dévastation identitaire engendrés par la violence du colonialisme, semble s’imposer comme la seule issue possible.
Par la suite, le problème de la relation entre les deux long-métrages, celui algérien de Zahzah sorti en 2024 et le film de Barny sorti en 2025 doit être abordé. S’agissant de Fanon, on ne peut pas ignorer les rapports de subordination et de pouvoir qui sous-tendent à la création artistique, lorsqu’un produit euro-américain est confronté à un produit africain. Last but not least, la question de l’interview accordée par Barny aux micros de Radio J, dans l’après-midi du 1er avril 2025. Si le sujet n’était pas d’une gravité extrême, on pourrait penser que le choix de parler de Fanon sur le plateau d’un média qui défend ouvertement le génocide en Palestine, se faisant le porte-voix de la pire propagande du gouvernement israélien dans l’espace francophone, n’est qu’un poisson d’avril de mauvais goût. Au contraire, aucune ironie : Jean-Claude Barny a en fait parlé de Frantz Fanon et d’humanisme, entrecoupé par les brèves de presse rapportant les propos du Ministre des Finances israélien, le fasciste suprématiste Belazel Smotrich.
Mélancolie postcoloniale
Les manipulations artificielles infligées à la biographie de Fanon dans le film de Barny sont nombreuses. Ne s’agissant pas d’un livre d’histoire, le réalisateur est libre d’apporter les changements stylistiques qu’il souhaite à la vie de son sujet d’investigation. Il en va autrement lorsque ces inexactitudes interviennent dans le contexte d’une histoire plus vaste, déformant sciemment le cours des événements que le cinéaste prétend dépeindre objectivement, s’adressant à un large public qui ne maîtrise pas le sujet. C’est notamment le cas lorsqu’on décide de se pencher sur la vie de Frantz Fanon, dans le cadre de la guerre de décolonisation algérienne.
Le premier détail qui a retenu mon attention est la rhétorique du « racisme infra-communautaire » dont Fanon aurait souffert après son arrivée à la clinique de Blida-Joinville, à partir de 1953. La méfiance initiale des indigènes à son égard, lui qui était un médecin noir dans une société d’« Arabes », semble se résoudre au récit stéréotypé d’une société coloniale en ébullition. Le regard racialement symétrique qu’il aurait subi de la part des indigènes et des colons à cause de sa prise de poste dans la clinique serait pourtant balayé par son approche novatrice. La réalité est tout autre : selon ses biographes, l’arrivée à Blida marque le moment où le jeune psychiatre prend effectivement conscience de la structuration sociale dichotomique de l’Algérie coloniale. Barny choisit de se concentrer uniquement sur les patients musulmans hébergés dans la clinique de Blida, en omettant le fait que Fanon a en réalité travaillé avec environ 200 patients, dont 165 femmes « algériennes européennes » et 22 hommes « musulmans », vivant dans un contexte de séparation absolue1. Ceci est son premier contact, intime et puissant, avec la « dichotomie coloniale », qui deviendra plus tard la pierre angulaire de sa pensée politique anticolonialiste. En représentant la clinique de Blida comme un asile réservé aux indigènes, le choc violent avec le monde manichéen de la colonie est occulté. Il est donc possible pour le réalisateur de déformer l’histoire de la prise en charge de Fanon d’un policier tortionnaire. Dans le film de Barny, un soldat de l’armée française se rend à la clinique de Blida en tant qu’agent infiltré, envoyé par un colonel machiavélique désireux d’en savoir plus sur les activités clandestines menées par le psychiatre à l’intérieur de l’hôpital. Mêlé aux patients « musulmans », il réussit ainsi à extorquer des informations et à monter une opération de ratissage planifiée par les hiérarchies militaires. Au final, impressionné par l’expérience vécue à Blida, il finira par désobéir aux ordres et sympathiser avec les insurgés algériens.
Or, rien n’est plus faux : les patients « européens » et les indigènes vivaient dans deux cliniques radicalement séparées. Fanon a en effet soigné deux policiers souffrant de troubles du comportement à la suite des tortures qu’ils avaient infligées aux résistants algériens. Le premier, nous dit-il dans « Les damnés de la terre », refuse l’hospitalisation et se fait soigner en privé par Fanon à son domicile ; puis, lors d’une crise, il se précipite à Blida où, tombant nez-à-nez sur l’un des Algériens qu’il avait lui-même torturés, il tente de se suicider dans les latrines de l’hôpital. Un certificat délivré par Fanon lui-même lui permettra finalement de rentrer en France, échappant ainsi à l’engrenage infernal de la violence coloniale. Le second soldat dont Fanon relate l’histoire dans les Damnés a, quant à lui, été envoyé à la clinique par sa hiérarchie, car en proie à des accès de rage contre sa femme et ses enfants. Fanon refusera de le soigner car « il me demandait sans ambages de l’aider à torturer les patriotes algériens sans remords de conscience, sans troubles de comportement, avec sérénité»2. Il n’y a pas de trace, donc, d’infiltrés français parmi les patients « musulmans », comme représenté dans le film de Barny : les patients de Fanon font l’expérience de la séparation radicale qui caractérise les relations sociales dans l’Algérie française. Le présumé brassage intra-communautaire qui, dans le regard du réalisateur, caractériserait le microcosme de la clinique représente une société qui n’a jamais existé, ne permettant pas de comprendre la maturation du Fanon politique, ni sa théorie de la violence.
Une autre dichotomie est mise en avant par les scénaristes, en lieu et place de la dichotomie coloniale. Celle qui sépare les membres « démocratiques » du FLN des « colonels », qui auraient pris le contrôle du mouvement nationaliste par la force. Il s’agit d’un topos typique du discours sur l’Algérie postcoloniale, qui trouve son origine dans des éléments factuels. Cependant, le mythe d’un front nationaliste bon et démocratique écrasé par les membres de certains groupes proches de l’Etat-major de l’Armée de libération nationale (ALN) algérienne sert davantage à alimenter le trope orientaliste de la nécessaire dégénérescence des régimes « arabes » post-coloniaux, qu’à mettre en lumière la complexité des relations politiques et psychologiques qui ont mûri parmi les dirigeants nationalistes algériens, dans le contexte d’une guerre de libération extrêmement cruelle. En d’autres termes, il est anachronique, voire insensé, de projeter les frustrations des années 2020 sur le passé. D’autant plus que personne ne misait, avant 1962, sur la victoire effective du FLN contre le rouleau compresseur de la France coloniale.
Dans ce contexte, la figure d’Abane Ramdane est largement évoquée. Dirigeant du FLN durant la première phase de l’insurrection algérienne, Abane est effectivement liquidé dans le cadre des luttes intestines qui rythment la vie interne du mouvement nationaliste. Pourtant, il était tout sauf un saint, ou plutôt un prophète de cette « dimuqratia » que son interprète, Sami Kali, ne cesse d’évoquer tout au long du film. Abane est le protagoniste, comme les autres chefs du Front, d’une lutte fratricide et violente, dans le contexte d’une guerre asymétrique parmi les plus dures du 20ème siècle. Il est victime du paroxysme de la violence au sein du FLN, qu’il a lui-même, comme ses camarades, contribué à fomenter. Traiter de manière dichotomique un sujet aussi complexe et douloureux a un sens politique très précis, soixante-trois ans après la déclaration d’indépendance de l’Algérie : disqualifier aux yeux de la jeunesse racisée l’ensemble du processus d’indépendance, dont la dégénérescence est imputable à l’autoritarisme naturel des « colonels ».
Or, Fanon et Abane travaillent ensemble à Tunis à la rédaction du Moudjahid, organe officiel du FLN. Selon certains témoignages, les deux hommes finissent par nouer une amitié qui dépasse les frontières de leur activité politique. Simone de Beauvoir affirme dans ses mémoires que lors d’une conversation, Fanon avait affirmé d’avoir deux morts sur la conscience : celle d’Abane et celle de Lumumba3. Cependant, une fois encore, la question est bien plus complexe et mérite d’être traitée en profondeur, au-delà des approximations simplistes. Ce qui est certain, c’est qu’au cours des quatre années qui se sont écoulées entre le 27 décembre 1957, jour où Abane est assassiné, et le 6 décembre 1961, jour de son décès, Fanon a gravi les échelons au sein du FLN, accédant à des postes de direction. Les témoignages de ses collaborateurs pendant la période de sa clandestinité, qui s’est déroulée principalement entre la Tunisie, le Maroc et l’Afrique occidentale, font état des visites qu’il recevait régulièrement par le chef d’état-major de l’ALN, le colonel Houari Boumédiène4. Une photo non datée montre d’ailleurs Fanon lors d’une réunion politique en présence du jeune Abdelaziz Bouteflika, futur ministre des Affaires étrangères de Boumédiène et président de la République algérienne entre 1999 et 20195. En juillet 1959, c’est ce dernier, alors dirigeant du Front au Maroc, qui sauve la vie de Fanon, gravement blessé dans un accident de voiture, en organisant son transfert d’urgence à Rome, où il sera hospitalisé dans un état grave.
Quiconque possède des notions élémentaires sur l’histoire algérienne ne pourra pas négliger que Boumédiène et Bouteflika se distingueront comme deux figures majeures au sein du groupe dirigeant du futur état post-colonial : le noyau dur de ces « colonels » évoqués dans le film de Barny. Loin d’être un démocrate sincère aux espoirs trahis, Frantz Fanon a entretenu avec la direction du FLN des relations autant intenses et contradictoires, que complexes et multiformes, oscillant entre le soutien à des différents groupes en lutte entre eux. Non sans souffrances personnelles et hésitations politiques, sur lesquelles le cinéaste aurait pu aisément se focaliser, au lieu de présenter aux jeunes générations un portrait fantaisiste d’une Algérie inexistante et stéréotypée. D’autre part, du moment que Barny omet de façon macroscopique des aspects fondamentaux de la vie de Fanon, pourquoi ne pas gagner du métrage, se consacrant à des aspects plus passionnants et moins connus de sa vie, comme le temps qu’il passa en Afrique, coordonnant les révolutionnaires panafricanistes ? Mettre le doigt sur le fléau des blessures post-coloniales devait lui paraitre plus facile. Il s’agit, plus probablement, d’un choix politique précis : édulcorer la biographie du révolutionnaire martiniquais-algérien pour en dresser un portrait plus – ou mieux – acceptable en Europe.
Les funérailles de Fanon clôturent ce récit déformé. Enveloppé dans un linceul vert, il est enterré par six paysans algériens au milieu d’un plateau isolé. Visant à souligner l’isolement dont Fanon aurait souffert au sein du FLN, cette image ne saurait être moins véridique : sa biographie a pour la énième fois été manipulée. Conformément aux dernières volontés de Fanon, et alors que la guerre est toujours en cours, il est enterré sur le sol algérien, à quelques kilomètres de la frontière tunisienne, dans un cercueil porté par des soldats en uniforme de l’ALN. Il n’est pas mort seul, célébré par la prière discrète de quelques paysans anonymes. Traité comme un martyr de la révolution, il a plutôt été inhumé selon ses vœux, dans une opération risquée menée par une poignée de soldats en uniforme à la présence de quelques dirigeants politiques du Front6. D’ailleurs, Fanon est décédé dans un lit d’hôpital de la ville de Washington, aux Etats Unis : c’est le FLN qui se charge du transfert de sa dépouille et de l’organisation de ses funérailles en Algérie.
Pour Barny, raconter son isolement, signifie raconter l’isolement d’une Algérie prétendument démocratique, marginalisée et oubliée par ses dirigeants politiques et incarnée par le linceul vert contenant la dépouille de Fanon. Un anachronisme qui ne fait que noyer l’histoire de la libération armée dans le piège d’une mélancolie post-coloniale, ancrée au mythe de la voie démocratique non empruntée. Se permettre de jouer ainsi avec les identités fragiles et acerbes de pays émergeant du traumatisme colonial est le symptôme d’une absence chronique de délicatesse et profondeur. Deux caractéristiques absentes dans le travail de Barny, qui préfère, pour des raisons d’opportunité, le sensationnalisme esthétique à l’introspection. Mais à quel prix ?
Peau noire, production blanche ?
La critique pourrait s’arrêter là. Cependant, la coexistence de deux longs-métrages sortis pratiquement en même temps sur la vie du révolutionnaire martiniquais-algérien nécessite quelques éclaircissements. Abdenour Zahzah, dont le film sur Fanon a été présenté en 2024 mais non distribué en France, ne s’intéresse qu’à la période où il a été nommé chef de service à Blida. C’est un travail méticuleux, qui tente de conjuguer l’attention portée à la pratique clinique effectivement menée par Fanon dans le contexte du durcissement de la guerre d’indépendance algérienne. Le film se termine avec une scène refigurant la remise de faux documents par un cadre du FLN et l’entrée de Fanon en clandestinité. Le reste appartient à l’histoire.
Le fait que deux films presque identiques soient sortis pratiquement en même temps n’enlève rien à la bonne foi des deux réalisateurs. Paradoxalement, le problème est ici colonial, ou plutôt néocolonial. La sortie du film de Barny dans les salles françaises est à l’origine d’une autre dichotomie – l’énième -, qui caractérise la relation entre les deux œuvres. Alors que la polémique, alimentée par le distributeur officiel du film, monte dans l’Hexagone à propos d’un prétendu boycott du biopic de Barny7, le long métrage de Zahzah fait le tour des capitales africaines, remportant prix et récompenses. Dernièrement, en Egypte, où il a remporté le Prix du Jury au Festival du cinéma africain de Louxor, et au Burkina Faso, où il a remporté le prestigieux Prix de la Semaine de la Critique au 29ème Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Et voilà le paradoxe. Cent ans après la naissance de Fanon, deux films se font face dans l’arène médiatico-commerciale, sans communiquer entre eux. Le premier est produit avec 800 000 dollars, financé principalement par le Ministère de la Culture algérien. Le second est le fruit d’une production franco-luxembourgeoise-canadienne, avec un budget de 3,284 millions d’euros : quatre fois plus. Jean-Claude Barny, réalisateur connu et actif au nord de la Méditerranée, aurait pu nouer un dialogue fructueux avec l’auteur du produit algérien. Au contraire, pas un mot n’a été prononcé pour inviter le public français à s’approcher du produit africain, qui est resté relégué à quelques festivals spécialisés. Les spectateurs auraient pu prendre conscience de l’existence d’un autre Fanon, peut-être plus radical et plus fidèle à la vérité que celui, stéréotypé et déformé, proposé par Barny. On pourrait opposer à mon argument des objections relatives à la liberté d’expression artistique ou à la pluralité des voix nécessaires pour restituer toute la complexité d’un personnage aussi multiforme que Fanon. Ce qui est certain, cependant, c’est qu’il ne s’agit pas ici d’un sujet neutre, qui appartiendrait à tout le monde. Fanon et son héritage politique sont, par définition, des sujets clivants. Son appel incontestable à un humanisme universel, qui conclut les Damnés, présuppose avant tout l’affirmation de l’autonomie culturelle et identitaire des colonisés. Voir un produit européen éclipser les efforts déployé par un artiste africain dans un contexte difficile ne peut que conduire, en termes fanoniens, à solidariser avec ce dernier. Ne serait-ce que pour la proximité et le rapprochement avec un produit mûri parmi les enfants de ces « Damnés » que, grâce à Fanon, le monde entier a appris à connaître.
Fanon à Gaza
Comme mentionné au début, j’avais décidé de ne rien écrire sur le Fanon de Barny jusqu’à ce qu’une amie me signale le post Instagram de ‘Perspectives radicales’ critiquant le film. Parmi les points problématiques soulevés, les auteurs du post pointent du doigt la participation de Barny à une interview sur « Radio J », qui a eu lieu l’après-midi du 1er avril. Interviewé par la journaliste Cyrielle Sarah Cohen pendant une cinquantaine de minutes, Barny se livre à un panégyrique de la paix entre les peuples et à un éloge démesuré de l’amour universel, sous le signe du rejet du racisme. Les deux commencent l’entretien en discutant des banlieues françaises. L’expérience du réalisateur en tant que responsable du casting du film « la Haine » est évoquée. La nostalgie des banlieusards « qui voulaient s’en sortir », juxtaposés aux nouvelles générations, victimes des « fractures communautaires » (min. 7:00) prédominantes aujourd’hui, est mentionnée par la journaliste, en face au du réalisateur, qui reste en silence. Puis, on passe à l’examen du film. L’éloge dépassionné de la complexité du Fanon que nous présente Barny s’accompagne d’une reconnaissance de sa « non-radicalité » (12:40) : l’homme qui a abandonné sa vie aisée de psychiatre pour embrasser la cause de la libération armée d’un peuple qui lui était jusqu’alors inconnu est pour le réalisateur un exemple valable de « nuance ».
D’ailleurs, Cohen et Barny en conviennent plus loin dans leur échange (min. 21:00) : Fanon était un colon à son arrivée en Algérie, tant pour les Français, qui le rejetaient à cause de la couleur de sa peau, que pour les Algériens « qui ne sont pas forcément fans de lui quand il arrive dans leur pays ». La couleur de la peau est à l’origine d’une forme de racisme symétrique que le jeune psychiatre aurait subi à son arrivée en Algérie. Nul besoin de se référer au concept de ligne de couleur pour comprendre qu’il s’agit là de propos extrêmement déplacés, visant à faire de Fanon un héros aux traits épiques, luttant contre le monde raciste des Arabes et des Blancs qu’était, aux yeux du réalisateur, l’Algérie française. Il suffit de lire ses textes, ne serait-ce que les premières lignes des Damnés, pour mettre en évidence la mauvaise foi de ces propos, destinées davantage à alimenter le confusionnisme, qu’à éclairer le profil réel de Frantz Fanon et son rapport aux populations indigènes en Algérie. Le regard chargé de « préjugés », « caricatural » que les Algériens auraient porté sur le jeune psychiatre à la peau noire ne trouve aucune confirmation factuelle dans les études historiques traitant du sujet. Au contraire, dans le contexte de la France impériale, et plus particulièrement de la guerre de décolonisation algérienne, le problème de la peau noire était incarné par les milliers de « tirailleurs sénégalais » déployés par le gouvernement de Paris afin de réprimer l’insurrection. Une contradiction que Fanon lui-même ne cesse d’analyser dans ses écrits et contre laquelle il lutte activement avec pour but la fin de l’emploi de ces jeunes hommes africains dans la torture et la répression des insurgés algériens. Dans le système interconnecté de l’empire français, les hiérarchies raciales se font et se défont au gré du contexte politique et des exigences de gestion des corps et des esprits des sujets indigènes. Le discours essentialisant sur la question raciale développé par Cohen et Barny au cours de leur dialogue ne sert qu’à masquer la brutalité du pouvoir colonial. Leur but : nuancer, ou mieux éteindre, l’analyse sur la violence absolue régissant la colonie, dont Fanon est pourtant le théoricien.
Il serait possible de poursuivre l’examen de l’interview de Barny sur les ondes de Radio J, mais il n’est pas nécessaire d’accabler davantage les lecteurs. Il suffit d’évoquer l’interruption qui a lieu vers la minute vingt, afin de laisser la place aux brèves de presse provenant d’Israél. La journaliste Eitanite Belaïche s’intéresse à ce que l’on appelle dans le jargon ultra-sioniste la « Judée et Samarie », c’est-à-dire la Cisjordanie. Candidement, sont repris les propos du Ministre de finances d’extrême droite Smotrich, qui réitère son opposition à ce que l’Autorité nationale palestinienne « reprenne le contrôle de ce territoire » – la Palestine, selon le droit international. Puis, toujours sur le même ton décomplexé, vient l’annonce de Smotrich selon laquelle, en 2024, « le record de démolitions de constructions arabes en Judée et Samarie a été battu ». La conversation entre Cohen et Barny reprend ensuite, comme si de rien n’était, se penchant sur « l’humanisme » de Fanon.
Entendre le nom de l’un des plus grands révolutionnaires antiracistes que l’histoire n’ait jamais connu, prononcé depuis le plateau d’une radio qui accueille régulièrement des officiers supérieurs de l’armée israélienne en train de commettre un génocide colonial donne des frissons. Fanon ne s’est pas occupé de Palestine durant sa courte vie. Nous ne savons pas ce que l’avenir lui aurait réservé. Cependant, un fait est établi : l’engagement de sa compagne Josie en faveur du peuple palestinien, jusqu’à sa mort en 1989. Présentée par Barny comme une simple assistante habituée à taper les mots dictés par son mari, Josie Fanon a au contraire joué un rôle de premier plan dans la maturation politique et dans le processus éditorial des textes du mari, Frantz, militant à part entière dans les rangs du FLN. Après la mort de Fanon, elle restera en Algérie, continuant à travailler à la rédaction du Moudjahid – l’organe du Front – et collaborant avec la revue panafricaniste « Révolution africaine ». En 1967, c’est Josie qui téléphone d’urgence à François Maspero pour lui demander de retirer la préface de Sartre des futures éditions des Damnés. Le philosophe venait de signer une pétition en faveur du droit d’Israël à se défendre, dans le cadre de la guerre de Six jours8.
A l’heure de l’appropriation néocolonialiste de la figure de Fanon, il est nécessaire d’élever la voix et de défendre sa mémoire et son héritage révolutionnaire commun de toute tentative de récupération. Le film de Jean-Claude Barny en est un exemple marquant.
Nicola Lamri
Notes :
1 David Macey, Frantz Fanon, une vie, Paris, La Découverte, 2013, p. 243.
2 F. Fanon, Les damnés de la Terre, Paris, Maspero, 1970, p. 189-94.
3 Simone De Beauvoir, La force des choses, Paris, Gallimard, vol. II, p. 432.
4 D. Macey, Frantz Fanon, cit., p. 415.
5 La photo en question est disponible ici : Philippe Triay, « Frantz Fanon (20 juillet 1925 – 06 décembre 1961) : un parcours exceptionnel en huit photos », FranceInfo, 6 décembre 2021, https://la1ere.francetvinfo.fr/frantz-fanon-20-juillet-1925-06-decembre-1961-un-parcours-exceptionnel-en-huit-photos-1171165.html.
6 Une photo de l’enterrement est disponible ici : « Les funérailles de Fanon : une opération risquée », FranceAntilles-Martinique, 6 décembre 2021, https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/culture/les-funerailles-de-fanon-une-operation-risquee-186632.php.
7 « Fanon »: le biopic sur la figure de l’anticolonialisme est peu diffusé dans les cinémas mais agite les réseaux, RadioFrance, 8 avril 2025, https://www.radiofrance.fr/mouv/podcasts/quinze/fanon-le-biopic-sur-la-figure-de-l-anticolonialisme-est-peu-diffuse-dans-les-cinemas-mais-agite-les-reseaux-1836300.
8 Jessica Breakey, “Josie Fanon and her fidelity to Palestinian liberation”, Verso Blog, 28 mars 2024, https://www.versobooks.com/blogs/news/josie-fanon-and-her-fidelity-to-palestinian-liberation?srsltid=AfmBOoqJN_QhJSjZyITtoKD8kM-KUGxrv6drv5kJqDhXfq1b4nDh4hDa.
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 662 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
"France3-régions"
06/03/2026 - 15:51
Breiz-info.com
26/02/2026 - 22:43
Laura Spinney ("Observer.co.uk")
24/02/2026 - 08:04
19/02/2026 - 10:07
Commentaires récents
Il dispose des armes les plus puissantes du monde mais a besoin de la protection de...Dieu
Nom de Dieu!...
Frédéric C.
06/03/2026 - 22:47
...Ce Schtroumpf orange* demande à son Dieu sa bénédiction pour aller tuer des milliers de gens! Lire la suite
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
Je ne veux pas paraitre complotiste ,mais...
yug
06/03/2026 - 06:56
...je ne serais pas étonné que l'invraisemblable diabolisation manifestement concertée déferlant Lire la suite
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
@Lidé, quand j’écris "vide"...
Frédéric C.
04/03/2026 - 19:28
...je veux dire que, comme la nature à horreur du vide", cet Occident (tel que dirigé par ses bou Lire la suite
Derrière la diabolisation de Mélenchon, la haine du "bougnoule"
@Lidé, je formulerais ça autrement...
Frédéric C.
04/03/2026 - 19:19
...parce qu’en Occident il existe des forces "saines", qui luttent contre leurs propres impériali Lire la suite
Carnaval : le Danmyé de la discorde
Monthieux ou Michel taube ? qui encourage la chasse aux noirs?
@Lidé
04/03/2026 - 18:22
fondaskreyol est-il en accord avec le site opinion-internationale?
Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Municipales au Prêcheur : une bande de bouffons
- Il dispose des armes les plus puissantes du monde mais a besoin de la protection de...Dieu
- Nancy : Rachid Rafaa ni djihadiste, ni fiché S selon son avocate
- Martinique : Les acteurs économiques apportent leur soutien à la distillerie Neisson menacée par un projet d'élargissement routier
- Des déchets et encombrants dispersés partout à Saint-Pierre
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus


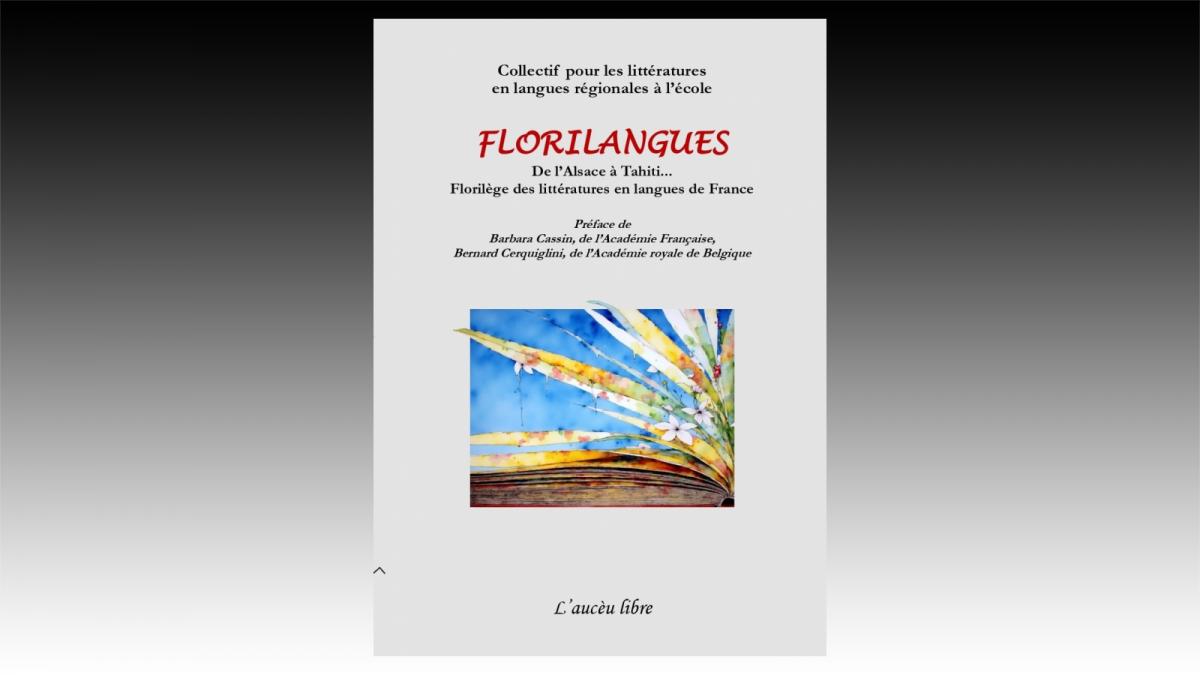



Commentaires
Un article à lire et à relire
Karl
08/05/2025 - 19:29
Enfin un article qui restitue l'homme dans sa complexité et qui fuit les visions simplistes, en noir et blanc en quelque sorte, trop souvent utilisées quand on évoque l'œuvre et la vie d'un homme qui a marqué son époque.
Cet article soulève mille questions que méritent d'être approfondies.