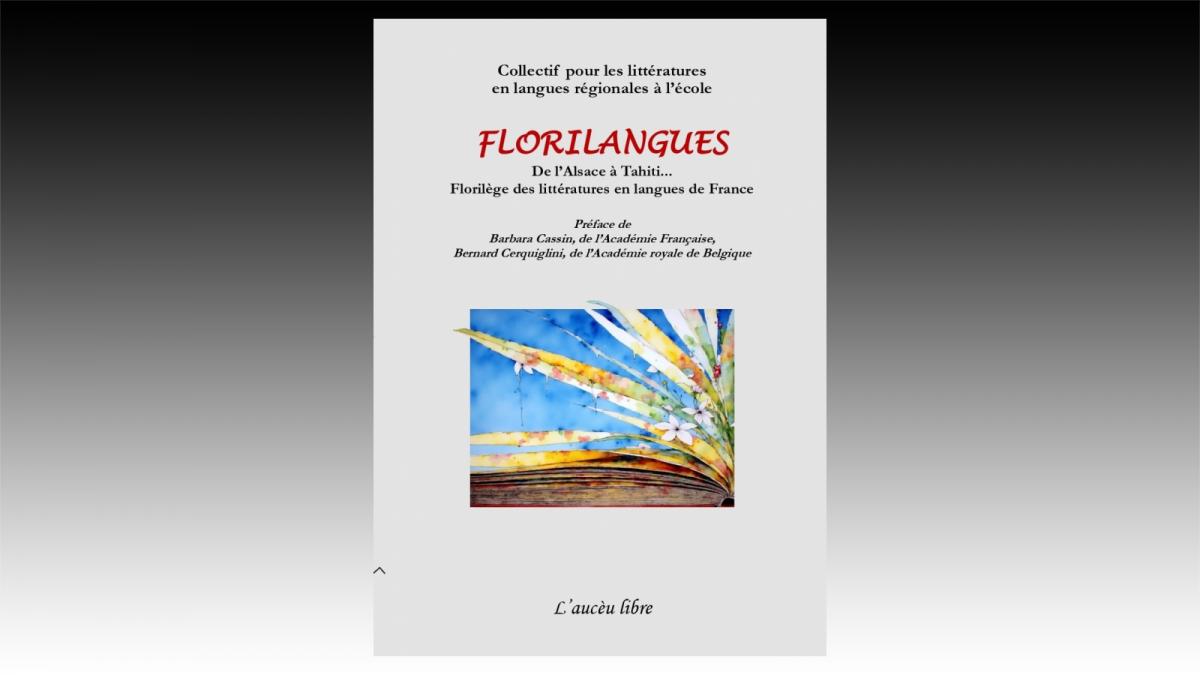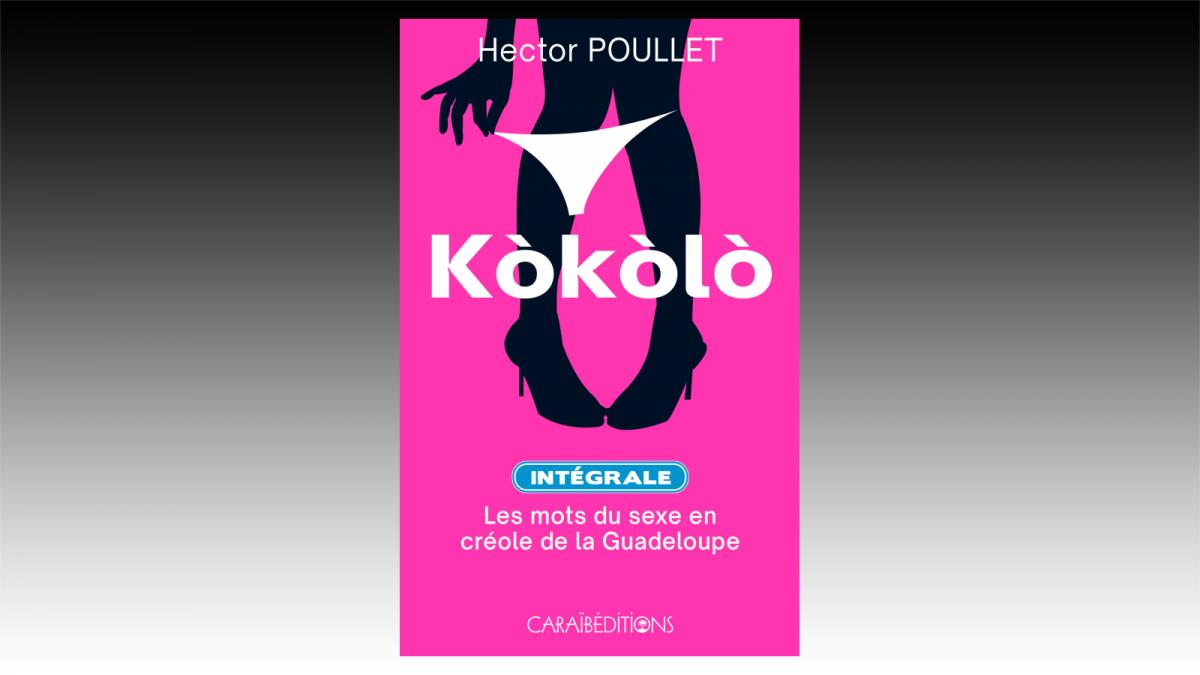Le maloya, une musique passée de la clandestinité à la célébrité

Saint-Denis, 1959. Le journal Témoignages, organe médiatique du tout jeune Parti communiste réunionnais (PCR), organise une fête au Rio, une salle tenue par un sympathisant. Habituellement, l’animation musicale y est assurée par l’Orchestre Jazz Tropical. Mais ce jour-là, c’est une troupe de maloya qui est venue ambiancer les militants. Cet événement, devenu historique, marque l’entrée éphémère dans l’espace public réunionnais de cette musique héritée de l’esclavage – dont on commémore l’abolition sur l’île française ce lundi 20 décembre –, avant qu’elle ne soit condamnée à la clandestinité.
Parmi les musiciens présents, un certain Firmin Viry, alors âgé de 24 ans. Il en a 86 aujourd’hui et lorsque nous le rencontrons, vendredi 10 décembre, alors qu’il s’apprête à monter sur la scène du Sakifo Musik Festival à Saint-Pierre (sud), il ne s’attarde pas sur cet épisode. « J’ai déjà sauté la rivière », dit-il dans son créole imagé pour signifier que ce temps est révolu. Mais il poursuit : « C’était la résistance, le maloya était surveillé de près. On se retrouvait dans les cours familiales ou dans des abris loin des regards. Le mot circulait, on se tenait informés des déplacements des forces de l’ordre. »
Car si le maloya, inscrit en 2009 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, est aujourd’hui la carte de visite musicale de la Réunion à l’international, cela n’a pas toujours été le cas. En 1960, le premier ministre Michel Debré promulgue un décret visant à éloigner des colonies les fonctionnaires indépendantistes, particulièrement en Algérie et, en ce qui concerne la Réunion, les communistes. En 1963, alors qu’il n’y a jamais mis les pieds, il est élu député de ce territoire ayant acquis le statut de département d’outre-mer en 1946. Sur place, il poursuit la lutte avec le PCR, dont le maloya, privé de radio et de télé, sera la victime collatérale : on parle de rassemblements interdits, d’instruments confisqués voire brûlés, de musiciens arrêtés.
D’une musique de « race » à une musique de « classe »
« A ma connaissance, il n’y a pas eu de texte interdisant explicitement le genre musical », précise l’ethnomusicologue Guillaume Samson, chargé d’études au Pôle régional des musiques actuelles (PRMA) et co-auteur d’un ouvrage de référence sur L’Univers du maloya (avec Benjamin Lagarde et Carpanin Marimoutou, 2008, épuisé) : « On était dans une période d’opposition entre départementalistes et autonomistes, et comme le maloya était beaucoup joué par des militants du PCR, la répression l’a également touché. Mais il y avait aussi une forme d’interdiction sociale liée à la hiérarchie culturelle du monde colonial, les musiques de descendants d’Africains étant jugées inférieures à celles des descendants d’Européens. Si bien qu’on n’osait pas revendiquer le maloya. »
Cela n’empêchera pas Firmin Viry d’enregistrer en 1976 le tout premier 33-tours de maloya traditionnel à l’occasion du quatrième congrès du PCR, qui s’emploie à l’époque à faire passer ce genre d’une musique de « race » à une musique de « classe ». Analphabète, fils de planteur sucrier, lui-même planteur puis ouvrier dans une usine de cigarettes, il raconte : « Je composais mes chansons au rythme de la cadence des machines. Puis une fois rentré à la maison, je chantais ce que j’avais composé à une de mes filles, qui le retranscrivait. Mes textes parlaient de la souffrance, de la vie quotidienne. » Avec souvent des doubles sens propres à la langue créole et qui permettaient une interprétation plus politique…
A l’origine, cette dimension contestataire n’est pourtant pas primordiale dans le maloya. Cette musique, qui est aux plantations de café puis de canne à sucre de la Réunion ce que le blues est aux champs de coton des Etats-Unis, est le fruit d’un métissage entre descendants d’esclaves africains (les « Cafres ») et d’engagés indiens (les « Malbars », recrutés après l’abolition de l’esclavage pour fournir de la main-d’œuvre bon marché) et répond autant à des fonctions de cohésion sociale qu’à un usage rituel dans le cadre des « sèrvis », ces cérémonies d’hommage aux ancêtres, qu’ils soient issus de Madagascar ou d’Inde.
Sur le plan musical, le maloya, du moins dans sa forme traditionnelle, a ses instruments caractéristiques : l’emblématique kayamb, un « hochet en radeau » fabriqué à partir de tiges de fleurs de canne et rempli de graines ; le roulèr, un gros tambour sur barrique sur lequel on s’assoit ; le pikèr, un morceau de bambou qu’on frappe avec des baguettes ; le sati, son équivalent métallique, fait d’une boîte en fer-blanc ; et le bobre, un arc musical cousin du berimbau brésilien. Concernant les voix, une large place est accordée à l’improvisation et à « l’alternance responsoriale » entre un soliste et un chœur – une pratique héritée des chants de travail.
« Le maloya nous a forgés mentalement et socialement »
C’est cette tradition qui va finalement être réhabilitée et mise en valeur à partir de 1981, avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand. « Le ministre de la culture, Jack Lang, inverse alors le modèle d’André Malraux, qui était très descendant – des grandes œuvres de l’humanité vers le peuple –, en proposant une forme de démocratie culturelle favorisant la diversité des expressions », explique Guillaume Samson. Le maloya voit le bout du tunnel et profite en même temps de l’évolution de l’environnement culturel et économique, avec la libéralisation des radios et la structuration de l’industrie du disque.
Cette période « revivaliste », qui a commencé dès les années 1970, doit beaucoup à Danyèl Waro, le plus connu des artistes réunionnais, qui a popularisé le maloya au niveau mondial après l’avoir appris auprès de Firmin Viry dans son quartier de Ligne-Paradis, sur les hauteurs de Saint-Pierre. « Beaucoup sont passés chez moi, confirme l’octogénaire. Tous les gens qui aimaient cette musique, je leur ouvrais grand la porte. J’ai mis un peu d’eau, j’ai mis un peu de terre… et je continue d’arroser pour que ça pousse. » Et pour pousser, ça pousse ! Aujourd’hui, on ne compte plus les héritiers des « gramoun » (anciens), dont Firmin Viry est l’un des derniers représentants avant que la génération de Danyèl Waro accède à ce statut.
Parmi cette relève, Wilfrid Tugar, leader du groupe Tifrid Maloya, qui a enflammé la salle verte du Sakifo, le 10 décembre, insufflant dans cette grande case tressée de feuilles de palmiers une ambiance de « kabar », ces fêtes qui brouillent la frontière entre la scène et le public. Lui a été « initié » à l’âge de 8 ans par Granmoun Lélé (1930-2004) dans le quartier de Bras-Fusil, à Saint-Benoît (est) – « là où est né le maloya », affirme-t-il. « Mes parents sont issus de familles de musiciens, du côté de mon père, réunionnais, comme du côté de ma mère, qui vient de Madagascar. C’était la misère, ils n’avaient pas de moyens, mais pour nous la musique était bien plus importante que la richesse, c’est ce qui nous a forgés mentalement et socialement. »
Tifrid Maloya est composé de sept membres – uniquement des hommes – et pratique un maloya « cadencé », caractéristique de la côte est et plus rapide que le maloya « pléré », des complaintes associées au sud de l’île, selon Wilfrid Tugar. Le groupe, qui sévit autant dans les « kabar » profanes que dans les « sèrvis » religieux, sortira son premier album, Saviré, en mars. « On fait bien la différence entre les festivités et les cérémonies rituelles, on n’y joue pas les mêmes morceaux, prévient le trentenaire. Pour les bals et les concerts, ce sont des morceaux à message ou poétiques. Dans les cérémonies, ce sont des chants sacrés dédiés aux ancêtres. Mais dans l’album, il y aura de tout : du rituel, du traditionnel, de l’émotionnel… »
« Désormais, on apprend le maloya au Conservatoire »
C’est lors d’un « sèrvis » auquel l’avait amenée sa mère que Katy Toave, 48 ans, a découvert le maloya à l’adolescence. Née et ayant grandi en métropole, elle y accompagnait des groupes de musique réunionnaise en tant que choriste, avant de créer sa propre formation exclusivement féminine, Kafrine Do Fé, puis de « rentrer » sur l’île en 1998. Aujourd’hui leader du groupe Simangavole – six femmes et un homme –, avec lequel elle fera paraître en mars un quatrième album, Saouwalivé, dans l’objectif de « s’affranchir des codes patriarcaux du genre », elle observe avec optimisme la trajectoire du maloya, qui s’ouvre de plus en plus : « Autrefois, cette musique se transmettait plus facilement dans certains milieux, au sein des familles de musiciens. L’inscription au patrimoine de l’Unesco a changé beaucoup de choses, désormais on apprend même le maloya traditionnel au Conservatoire. »
Avant de nuancer : « Certes, le maloya est reconnu à l’international, mais pas encore assez à l’échelle de la Réunion, car cette musique est liée à un pan de l’histoire, l’esclavage, que certains ne veulent pas reconnaître. Il faut que la population accepte cette histoire et en fasse le deuil. » Certains artistes, osant la comparaison avec le zouk des Antilles, regrettent que leur musique n’ait jamais accouché d’un Kassav’ et que le maloya, bien que désormais promu par les institutions, passe encore trop peu sur les radios locales, qui lui préfèrent son cousin, le séga, ou des musiques internationales. Mais de la clandestinité à la popularité, il y a un pas que les nouvelles générations sont bien décidées à franchir. Sauter la rivière, en somme.
Sommaire de la série « Le maloya dans tous ses états »
Musique réunionnaise héritée de l’esclavage, le maloya a été banni de l’espace public dans les années 1960, avant d’être réhabilité en 1981 et même inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2009. Quarante ans après sa « libération », et alors que l’île française commémore le 20 décembre les 173 ans de l’abolition de l’esclavage, cette musique est plus vivante que jamais, que ce soit dans sa forme traditionnelle ou à travers de multiples fusions avec des genres venus d’ailleurs. A l’occasion du Marché des musiques de l’océan Indien (Iomma) et du Sakifo Musik Festival, deux événements qui se sont succédé à Saint-Pierre (sud) du 6 au 12 décembre, Le Monde est allé à la rencontre des artistes de différentes générations qui se transmettent le flambeau de cette tradition et la renouvellent sans cesse.
Episode 1 Le maloya, de la clandestinité à la célébrité
Episode 2 Le maloya, source intarissable de métissage
Episode 3 Le maloya, par et pour les femmes
photo : Le chanteur de maloya Firmin Viry, 86 ans, à Saint-Pierre, le 10 décembre 2021. FABIEN MOLLON
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 190 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Breiz-info.com
26/02/2026 - 22:43
Laura Spinney ("Observer.co.uk")
24/02/2026 - 08:04
19/02/2026 - 10:07
Commentaires récents
Rigoladeries au "Pays des océans"
Meu non...
Albè
02/03/2026 - 16:14
...des "océaniqués" :
Lire la suiteRigoladeries au "Pays des océans"
"Pays-des-Océans"? De pire en pire!...
Frédéric C.
02/03/2026 - 13:36
...et leurs "populations" on les appellerait comment ? Lire la suite
Plus fourbe que lui tu meurs...
Si vous ignorez ce qu’est le projet "Grand Israël "...
Frédéric C.
02/03/2026 - 13:30
...voici deux courts documentaires explicatifs, très clairs : Lire la suite
"Ils volent l'argent des Martiniquais !"
ABRUTI, VA !
Albè
02/03/2026 - 06:45
Que la France verse des "dotations" à ses régions hexagonales, ON N'EN A RIEN A FOUTRE : Dans not Lire la suite
"Ils volent l'argent des Martiniquais !"
Enculé 1er ,le roi des cons confond dotations et réparations !!
yug
01/03/2026 - 20:53
Albè ou si vous préférez Enculé 1er ,le Roi des cons a encore franchi une borne dans la bêtise .. Lire la suite
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- A Dubaï, les influensuceuses de bite ont la chiasse
- REPRESSION IMPITOYABLE EN COREE DU NORD
- Une "manawa" va présider le...Conseil de Sécurité de l'ONU !
- Plus fourbe que lui tu meurs...
- S'ils n'hésitent pas à massacrer des blonds aux yeux bleus...
Depuis toujours :
- Tous les présidents et premiers ministres de la Caraïbe sont vaccinés
- L'intolérable appauvrissement intellectuel et culturel de la Guadeloupe et dans une moindre mesure de la Martinique !
- LETTRE OUVERTE AU 31ème PREFET FRANCAIS DE MARTINIQUE
- L'arrière-grand-père maternel de Joan Bardella était...algérien
- Les triplement vaccinés contre le covid ne bandent plus